À Londres, ce 9 novembre 2016, l’aurore peine à naître. Un Australien de 45 ans, haut d’un mètre quatre-vingt-huit, s’affaire, recroquevillé sur son ordinateur. Au rez-de-chaussée d’un bâtiment en brique, caressant sa barbe et ses cheveux blanc cassé, il se sait, comme tous les jours depuis quatre ans, entouré d’une cinquantaine de policiers et d’un nombre inconnu d’agents du renseignement qui l’observent en se tenant prêts à intervenir au moindre mouvement. Ce matin-là, M. Donald Trump vient d’être élu 45e président des États-Unis. Un léger flottement semble s’être emparé du monde. Les abords de l’ambassade d’Équateur tremblent, eux, d’un quotidien inaltéré.
Quelques mois plus tôt, en plein cœur de l’été, Julian Assange déjouait la surveillance de ses geôliers et publiait, au nez et à la barbe de la première puissance mondiale, des milliers de courriels révélant comment la direction du Parti démocrate avait manipulé ses primaires afin de favoriser Mme Hillary Clinton au détriment de son concurrent de gauche Bernie Sanders. L’homme le plus surveillé du monde, arpentant, hagard, les étroits couloirs de l’appartement défraîchi qui sert d’emprise diplomatique à la République de l’Équateur, avait réussi à tromper la vigilance de tous ses ennemis. En un coup d’éclat, voilà que son sort se retrouvait au centre du jeu géopolitique mondial. Le réfugié politique le plus connu de la planète, coupable d’avoir publié des informations vérifiées, démontrait sa capacité à ne pas s’effondrer. En février 2016, l’Organisation des Nations unies (ONU) avait, par l’intermédiaire de son groupe de travail ad hoc, condamné le Royaume-Uni et la Suède (car elle est à l’origine du mandat d’arrêt européen), jugeant arbitraire la détention d’Assange et exigeant sa libération. Tout semblait autoriser une résolution heureuse. Pourtant, la divulgation des courriels de M. John Podesta, le directeur de campagne de Mme Clinton, allait provoquer une onde de choc médiatique qui rendrait inaudible toute parole raisonnable, à commencer par les conclusions de M. Barack Obama favorables à WikiLeaks (1).
Dix-neuf mai 2017. M. Baltasar Garzón, directeur de l’équipe de défense d’Assange, souhaite avancer avec précaution. La Suède vient d’abandonner ses poursuites contre son client, soupçonné d’agression sexuelle. Mais l’homme qui fit arrêter Augusto Pinochet et qui lutta contre Al-Qaida et contre M. George W. Bush sait que le plus difficile est devant lui. La situation de l’État équatorien, dont le revenu annuel n’atteint pas un septième du budget militaire américain, est précaire.
Des années de résistance aux pressions de Washington ont fini par entamer la combativité de son administration. M. Lenín Moreno, qui s’apprête à être investi président à la place de M. Rafael Correa, a refusé de rencontrer Assange. Et WikiLeaks vient de rendre public l’arsenal numérique de la Central Intelligence Agency (CIA), désactivant de facto l’ensemble des armes utilisées par l’agence pour pirater ses cibles. L’administration Trump, furieuse, comprend enfin qu’elle a face à elle un dissident, et non l’allié qu’elle avait cru pouvoir absorber.
Lorsque, en 2006, Assange crée une œuvre radicale qu’il fait nommer WikiLeaks, il est déjà une figure importante dans le milieu des hackeurs. Mais personne ne s’attend à ce que cet homme au visage encore juvénile fasse naître les fuites les plus massives de l’histoire, plongeant successivement ses lecteurs dans les manigances des ambassades proche-orientales, dans les arcanes du régime de M. Bachar Al-Assad ou dans les jeux oligarchiques des capitales africaines, sans oublier la corruption endogamique de la haute société américaine ou les relations du Service fédéral de sécurité (FSB) russe avec ses sous-traitants. Du manuel de la scientologie au fonctionnement d’une importante banque suisse en passant par le règlement intérieur de la prison de Guantánamo, les premières publications de WikiLeaks provoquent de sérieux remous. Et amènent le ministère de la défense américain à produire une enquête sur l’organisation… que WikiLeaks réussit à publier. D’importantes malversations sont révélées en Islande ; au Kenya, l’élection présidentielle de 2007 bascule après la divulgation d’un rapport secret concernant le candidat favori. Mais il manque encore au site un fait de gloire qui permette d’asseoir définitivement sa réputation.
En avril 2010, une vidéo d’un genre particulier va jouer ce rôle. Elle s’intitule Collateral Murder. Sur fond de commentaires oiseux, on y assiste, en noir et blanc, à l’assassinat de civils et de journalistes de Reuters par les forces américaines en Irak. Le carnage, filmé comme un jeu vidéo, avec en fond sonore les rires des assassins, suscite une onde de choc au sein des rédactions occidentales. Se découvrant visées, celles-ci affectent de découvrir le véritable visage des « guerres propres » menées par les États-Unis au Proche-Orient depuis 2001 ; des conflits qu’elles avaient très majoritairement soutenus jusqu’alors. Les preuves de milliers de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité publiées dans les mois qui suivent par WikiLeaks dans le cadre des « Afghanistan War Logs » et des « Iraq War Logs », en partenariat avec les plus prestigieuses rédactions occidentales, portent Assange au pinacle d’un espace médiatique en crise.
« Du sang sur les mains »
Alors qu’une palanquée d’organisations lui attribuent des prix, d’Amnesty International au Time en passant par The Economist et Le Monde, WikiLeaks enclenche la publication de dizaines de milliers de rapports de guerre, puis de 243 270 câbles diplomatiques américains. Ils révèlent l’étendue de la corruption des régimes arabes proches de Washington, et sont brandis par les manifestants tunisiens quelques jours avant la chute de M. Zine El-Abidine Ben Ali, en 2011. Mme Clinton, alors secrétaire d’État du président Obama, doit se résoudre à une tournée au cours de laquelle elle présente ses excuses aux alliés des États-Unis.
Universitaires et médias du monde entier se précipitent sur ces archives pour expliquer rétroactivement quelques-uns des événements majeurs des dernières années. Des milliers de procédures qui s’appuient sur les publications de WikiLeaks sont engagées devant les cours de justice. Les rédactions partenaires du site commencent alors à s’inquiéter. Elles se montrent débordées par un mode de fonctionnement qui fait fi des liens de consanguinité unissant les journalistes à leurs sources. Si elles doivent suivre celui qu’on présente comme le nouvel Hermès, elles laissent s’installer une tension grandissante, qui débouchera sur une rupture définitive.
Dès le 30 juillet 2010, les premiers articles accusant Assange d’avoir « du sang sur les mains » paraissent, y compris dans des journaux alliés à l’organisation (2). Alors que le département d’État américain met en place une équipe de plus de deux cents diplomates chargée d’étouffer WikiLeaks, une incrimination d’agression sexuelle visant Assange émerge en Suède. Elle ouvre la voie à un imbroglio juridique de plus de six ans dans lequel la presse va s’engouffrer. La rupture intervient quand WikiLeaks se désolidarise des méthodes de censure que les médias tentent d’appliquer aux câbles diplomatiques. Sur les chaînes d’information américaines, des intervenants se succèdent pour appeler à l’arrestation « coûte que coûte » de son fondateur, voire, comme M. Trump en 2010, à son exécution (3). Quand, en décembre 2010, Assange est arrêté à Londres, il ne peut déjà plus compter sur le soutien de ceux qui l’avaient célébré.
Sept ans et demi plus tard, le 28 juin 2018, M. Michael Pence, vice-président des États-Unis, rencontre le président Moreno à Quito. La rupture entre Assange et l’Équateur est consommée. Contre toute attente, le successeur de M. Correa s’échine à trahir son héritage (4), et il réclame l’appui financier des États-Unis. M. Pence se frotte les mains. Quelques mois plus tôt, le ministre de la justice américain, M. Jefferson (« Jeff ») Sessions, a fait de l’arrestation d’Assange une priorité. En avril 2017 déjà, le futur secrétaire d’État Michael Pompeo, alors directeur de la CIA, avait qualifié WikiLeaks d’« agence de renseignement non étatique hostile ». Assange a en effet pris le risque d’une confrontation directe avec M. Trump, comme il l’avait fait avec Mme Clinton lorsque celle-ci était pourtant donnée favorite.
Alors que l’isolationnisme du président des États-Unis l’oppose souvent à des administrations — diplomatiques et militaires — qui craignent pour leurs prérogatives et leurs budgets, Assange lui apparaît comme une monnaie d’échange commode dans la guerre d’usure qui l’oppose à l’« État profond ». M. Moreno, lui-même inquiété par des révélations de WikiLeaks pointant un enrichissement illicite, se dit prêt à des concessions ? Des accords commerciaux, économiques et militaires sont rapidement négociés, et le sort d’Assange est scellé. L’Équateur obtiendra un prêt de 10,2 milliards d’euros des institutions financières internationales sous influence américaine (Banque mondiale, Fonds monétaire international). Assange comprend alors que ses jours à l’ambassade sont comptés. Sollicité par mes soins, l’Élysée se refuse à intervenir pour accueillir celui qui a un enfant sur notre territoire et qui a rendu d’importants services à notre pays, notamment en révélant, en 2015, l’espionnage systématique par les services de renseignement américains des présidents français et des entreprises nationales participant à des appels d’offres supérieurs à 200 millions de dollars.
Lorsque l’arrestation d’Assange à l’ambassade d’Équateur intervient, le 11 avril 2019, en violation de toutes les conventions internationales relatives au droit d’asile, les rédactions occidentales, du Washington Post au Monde en passant par le Guardian et le New York Times, se montrent timorées, voire hostiles. Le sort d’un journaliste détenu depuis près de sept ans dans vingt mètres carrés, sans accès à l’air libre et au soleil, soumis à des mois d’isolement complet, dans des conditions de vie proches de la torture, le tout pour avoir fait son travail, ne les émeut pas. Assange a beau apparaître affaibli, le visage rongé par la solitude, il n’est plus des leurs.
Une âme naïve pourrait trouver étrange que celui qui a rendu publics certains des plus importants méfaits du XXIe siècle se retrouve à ce point esseulé lorsque la solidarité est requise. Lui qui, pas à pas et dans un extrême dénuement, aura constitué la plus importante bibliothèque des appareils de pouvoir de l’histoire a de surcroît accompli un exploit auquel aucun de ses concurrents ne peut prétendre : il n’a jamais, en treize ans, et tout en divulguant des millions de documents, publié la moindre fausse information ! Cela n’empêchera pas Le Monde d’estimer que « Julian Assange n’est pas un ami des droits de l’homme (5) », Mediapart de titrer sur sa « déchéance (6) », ou The Economist de se réjouir qu’il soit incarcéré (7).
Pour comprendre cette rupture avec le monde médiatique, il faut mesurer que le journalisme moderne fonctionne dans un cadre bourgeois, au sein d’un marché de l’information où la proximité avec les pouvoirs est une condition de survie dans un espace concurrentiel. Divers modèles coexistent. Des organes comme Mediapart en France, d’apparence plus transgressifs, pratiquent un « journalisme de révélation » qui recycle coups tordus et trahisons sans remettre en question le système dans lequel ces médias s’insèrent. En cela, ils ne se distinguent pas du journalisme de révérence qu’incarnent des institutions comme Le Monde, le Guardian ou le New York Times.
Assange a rompu avec ces deux modèles. Auteur d’une théorie sur le « journalisme scientifique », il s’est écarté des pratiques de ce qu’il considère comme un métier de connivence et, à mesure qu’il a révélé des informations plus importantes, il a appris à se tenir à distance de tout appareil de pouvoir. Il s’est contenté de publier des données rigoureusement sourcées, triées et analysées après avoir été filtrées via une plate-forme d’anonymisation dont lui seul détient les clés. Toute information figurant sur sa plate-forme est accompagnée d’une source brute qui permet à chacun de la vérifier et de s’en emparer, ce qui supprime les privilèges que la caste journalistique s’est octroyés.
Un tel pari sur l’intelligence collective renverse les principes de notre temps. Au-delà de l’effet de révélation immédiat, il permet l’émergence d’un regard critique partagé, éloigné de toute forme de connivence. Devenu une sorte de métamédia, WikiLeaks écrase toute concurrence et suscite d’intenses jalousies.
La radicalité de la démarche d’Assange n’autorise aucune forme de compromission avec les institutions existantes. Elle menace donc un espace médiatique qui s’est accommodé du confort que lui offre sa proximité avec les dominants. Et elle inquiète les appareils de pouvoir traditionnels, qui redoutent à tout moment de voir leurs forfaits exposés. Devenu un dissident malgré lui dans l’espace occidental, l’outsider australien a logiquement vu se succéder des accusations de viol, d’antisémitisme, de complotisme, et même d’inféodation aux services secrets russes. Huit ans après sa brusque émergence, celui qui était un héros est donc apparu, au moment de son arrestation, comme un « absolutiste de la transparence (8) » pour les uns et, pour les autres, comme un « ennemi des libertés (9) ».





















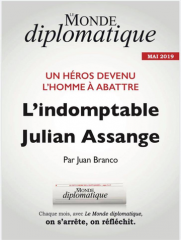
Les commentaires sont fermés.