30/06/2016
Où va donc la colère ?
Soulèvement, insurrection, révolte : le feu de la colère suscite un événement imprévisible, qui, entre fête et violence, entre allégresse et ressentiment, est toujours susceptible de bifurquer ou de se dévoyer, s’il n’est pas simplement écrasé ou canalisé par l’autorité contre laquelle il s’est dressé. C’est dire que révolte n’est pas synonyme d’émancipation.
par Georges Didi-Huberman
Il y a des « saintes colères », des colères justes. Mais comment discerner la justesse d’une colère, ou l’acte de justice qu’elle revendique ? Comment faire droit aux soulèvements et aux emportements passionnels qu’ils supposent toujours ? Comment légiférer sur des colères ? Que veut-on dire quand on les dit légitimes ? Que serait donc un droit de soulèvement ? En 1795 parut chez Jacquot, à Paris, un fascicule de cinq pages intitulé Insurrection en faveur des droits du peuple souverain. Il portait en exergue cet article, le trente-cinquième, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1793) : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Au même moment — soit en 1792 et 1793 —, les Enragés de la Révolution française publiaient leurs écrits, adresses ou pamphlets qui ont été, finalement, réunis sous le titre Notre patience est à bout (1). Bien plus tard, au Congrès anarchiste international d’Amsterdam de 1907, on vit se lever Emma Goldman lors de l’avant-dernière séance. Elle proposait à l’assemblée l’adoption d’un texte en faveur du droit de révolte. Elle lut la déclaration suivante, que son camarade Max Baginski avait signée avec elle :
« Le Congrès anarchiste international se déclare en faveur du droit de révolte de la part de l’individu comme de la part de la masse entière.
« Le Congrès est d’avis que les actes de révolte, surtout quand ils sont dirigés contre les représentants de l’État et de la ploutocratie, doivent être considérés d’un point de vue psychologique. Ils sont les résultats de l’impression profonde faite sur la psychologie de l’individu par la pression terrible de notre injustice sociale.
« On pourrait dire, comme règle, que seul l’esprit le plus noble, le plus sensible et le plus délicat est sujet à de profondes impressions se manifestant par la révolte interne et externe. Pris sous ce point de vue, les actes de révolte peuvent être caractérisés comme les conséquences socio-psychologiques d’un système insupportable ; et comme tels, ces actes, avec leurs causes et motifs, doivent être compris, plutôt que loués ou condamnés.
« Durant les périodes révolutionnaires, comme en Russie, l’acte de révolte, sans considérer son caractère psychologique, sert un double but : il mine la base même de la tyrannie et soulève l’enthousiasme des timides. (…)
« Le Congrès, en acceptant cette résolution, exprime son adhésion à l’acte individuel de révolte de même que sa solidarité avec l’insurrection collective. »
Le premier mot de « L’Iliade », au VIIIe siècle av. J.-C.
Mise aux voix, cette déclaration fut approuvée à l’unanimité. Et pourtant, elle ne laisse pas de surprendre par le « point de vue psychologique » qu’elle assumait d’emblée. Qu’a donc à faire la décision politique avec « l’esprit le plus sensible et le plus délicat [en tant que] sujet à de profondes impressions » ? Mais la colère évoquée par Emma Goldman renvoie bien à un « système insupportable » — un état de fait historique et politique — que la réaction subjective de cet « esprit », fût-elle collective, rend évidente. Il y a donc des colères historiquement justes, de justes colères politiques. On pourrait même considérer que la toute première chronique politico-militaire de l’Occident, au VIIIe siècle av. J.-C. — je parle, bien sûr, d’Homère et de L’Iliade —, porte, dès le début de sa toute première phrase, le mot « colère » (mènin) : « Chante, déesse [Muse], la colère d’Achille... »
Dans un livre intitulé Colère et temps — livre dont le titre original, Zorn und Zeit, joue polémiquement avec le Sein und Zeit de Heidegger —, Peter Sloterdijk a proposé une analyse « politico-psychologique » de la civilisation occidentale, pas moins (2). D’Homère à Lénine, donc, ce serait la colère qui émeut et qui meut les sociétés. Sauf que, dit-il, le destin de cette colère, par-delà l’« explosion simple » qu’elle constitue fondamentalement, est de ne trouver sa forme que dans un « projet ». Mais colère plus projet, cela ne donne-t-il pas que vengeance et ressentiment ? C’est comme si toute colère ne trouvait son « économie politique » que dans ce que Sloterdijk nommera pour finir, avec un cynisme certain, la « banque mondiale de la colère » que représente, à ses yeux, le projet révolutionnaire lui-même, avec Lénine et Mao Zedong en « entrepreneurs de la colère » tandis que les « petits porteurs » seront tous avalés dans ce gigantesque « fonds monétaire » des désirs d’émancipation...
L’impression que l’on retire de cette description très générale est que la colère, à peine reconnue dans sa puissance historique, se voit aussitôt réfutée, puisque rabattue sur les noirs desseins ou les noirs destins — vengeance, ressentiment, paranoïa — qui la canaliseraient fatalement. Où va donc la colère ? La tradition philosophique semble répondre qu’elle va mal dans tous les cas. Aussi ne trouve-t-on aucune trace de la « colère » — pas plus que de la « révolte » ou du « soulèvement » — dans le Dictionnaire de philosophie politique dirigé par Philippe Raynaud et Stéphane Rials (3). S’il y a bien une histoire philosophique de la révolution, d’Emmanuel Kant à Karl Marx et au-delà, il n’y aurait des soulèvements, avec leurs colères « psychologiques » afférentes, qu’une série sans suite de crises anachroniques. C’est comme si la colère elle-même contribuait à creuser la différence et, bientôt, l’opposition entre révolution et révolte, comme l’a bien raconté Alain Rey au plan de l’histoire sémantique (4).
Il reviendrait à une anthropologie politique de penser la colère à l’œuvre dans les gestes de soulèvements : de penser la puissance intrinsèque de son mouvement avant que de postuler son projet dans l’ordre des rapports de forces ou des questions de pouvoir. Ne pourrait-on imaginer une phénoménologie des colères politiques ? Certains sociologues — tels Jean Baechler (5), Vittorio Mathieu (6) ou Daniel Cefaï (7) — et historiens — tels Haim Burstin (8) sur les « sans-culottes » de 1789 ou Louis Hincker (9) sur les « citoyens-combattants » de 1848 — s’y sont essayés. Mais cela suppose un point de vue transversal aux constructions historiographiques et philosophiques standards, comme on le voit par exemple dans ce commentaire inédit de Georges Bataille au livre Humanisme et terreur de Maurice Merleau-Ponty : « Il est un point de vue plus général, que Hegel indique [sans le développer], et que l’angoisse dérobe à Merleau-Ponty. Mais il suppose une adhésion si entière à notre situation humaine qu’en quelque sorte on entre dans la convulsion elle-même (10). »
Bataille, à travers ces mots, indiquait un mouvement d’excès que le génie hégélien, selon lui, avait laissé entrevoir : quand la pensée même se met en colère sans rien lâcher de sa consistance et de sa rigueur. Voilà un point de vue anarchiste, sans aucun doute. Non par hasard, les textes de Michel Bakounine, réunis par Etienne Lesourd d’après Gregori Maximov sous le titre Théorie générale de la révolution, n’hésitent pas à construire quelque chose comme une équivalence anthropologique entre l’acte de penser et celui de se soulever (11). Les « deux facultés précieuses » et concomitantes accordées à l’espèce humaine, lit-on dans ces textes, seraient ainsi « la faculté de penser et la faculté, le besoin de se révolter » :
« L’homme ne devient réellement homme, il ne conquiert la possibilité de son développement et de son perfectionnement intérieur qu’à la condition d’avoir rompu, dans une certaine mesure pour le moins, les chaînes d’esclave que la nature fait peser sur tous ses enfants. (…) L’homme s’est émancipé, il s’est séparé de l’animalité et s’est constitué comme homme ; il a commencé son histoire et son développement proprement humain par un acte de désobéissance et de science, c’est-à-dire par la révolte et par la pensée. »
Dans les mêmes pages, Bakounine concluait qu’en somme la révolte n’est que l’autre face, négativement exprimée, de ce que désigne positivement le mot « jouissance ». On ne s’étonnera donc pas que Bakounine ait traversé la grande colère parisienne de février 1848 dans un sentiment de « griserie » ou d’« ivresse » qui ne se dit, d’habitude, que des fêtes les plus joyeuses, les plus exaltantes :
« Ce mois passé à Paris (…) fut un mois de griserie pour l’âme. Non seulement j’étais grisé, mais tous l’étaient : les uns de peur folle, les autres de folle extase, d’espoirs insensés. Je me levais à cinq ou quatre heures du matin, je me couchais à deux heures, restant sur pied toute la journée, allant à toutes les assemblées, réunions, clubs, cortèges, promenades ou démonstrations ; en un mot, j’aspirais par tous mes sens et par tous mes pores l’ivresse de l’atmosphère révolutionnaire.
« C’était une fête sans commencement et sans fin ; je voyais tout le monde et je ne voyais personne, car chaque individu se perdait dans la même foule innombrable et errante ; je parlais à tout le monde sans me rappeler ni mes paroles ni celles des autres, car l’attention était absorbée à chaque pas par des événements et des objets nouveaux, par des nouvelles inattendues. (…) Il semblait que l’univers entier fût renversé ; l’incroyable était devenu habituel, l’impossible possible, et le possible et l’habituel insensés. »
Incontestablement, la fête peut être dangereuse
En 1871, Jules Vallès à son tour décrira la Commune de Paris du point de vue — entre autres — d’une sorte de kermesse folle : « Est-ce qu’on est en révolution, papa ? demandent les enfants du marchand de vin, qui croient qu’il s’agit d’une fête (12)… » Façon de signifier que, dans tout soulèvement, la colère elle-même est de la fête, si l’on n’oublie pas, lecture des ethnologues aidant, qu’il y a aussi des fêtes piaculaires (faites de pleurs collectifs), des fêtes funèbres, des fêtes militaires, des fêtes ensauvagées, etc. Dans deux livres successifs — Fête et révolte en 1976 et Révoltes et révolutions en 1980 —, Yves-Marie Bercé a produit un tableau saisissant des pratiques de la colère sociale dans l’Europe prérévolutionnaire (13). L’image festive des soulèvements appartient sans doute à la mythologie que se donnent à eux-mêmes, sur le moment ou après coup, les acteurs de toute révolte. Mais c’est aussi que la fête, en tant que telle, manifeste bien ce que Bercé nomme une « virtualité subversive toujours présente ». Dans un nombre considérable de circonstances historiques — dont feront partie le deuil du général Lamarque chez Hugo dans Les Misérables ou celui du marin Vakoulintchouk chez Eisenstein dans Le Cuirassé « Potemkine » —, la violence subie provoque la fête, ou du moins ces ritualisations collectives qui vont de la minute de silence aux gestes du deuil ou à la procession derrière un mort qui réclame justice.
Or la fête est intrinsèquement puissance. C’est même pour cela qu’elle a Dionysos pour divinité tutélaire. Elle transforme la colère en puissance expansive, voire en puissance d’allégresse. Elle transforme le geste de peur ou d’agression en puissance chorégraphique. Elle est donc un opérateur fondamental pour ce renversement de toutes les valeurs dont les œuvres marquantes de Friedrich Nietzsche (14), puis de Florens Christian Rang (15) et de Mikhaïl Bakhtine (16) auront scandé l’élaboration philosophique. Dans le temps de la fête, qui est comme un « temps hors du temps », la colère devient joie et la violence parodie. Pourtant, écrit Bercé, il demeure incontestable « que la fête puisse être dangereuse », au sens du danger le plus trivial ou immédiat sur les personnes. Etudiant les beuveries rituelles, les parades armées, les « joyeux tribunaux de jeunesse », les fêtes de fous, les charivaris, les « quêtes rituelles » et autres « chevauchées de l’âne », Bercé aura décrit comment la fête ne tarde jamais à mettre les signes du pouvoir sens dessus dessous. En attendant de mettre sens dessus dessous le pouvoir lui-même.
Quand la foule du carnaval juge en grande pompe, puis met à mort une effigie du pouvoir, les procédures juridiques et policières sont souvent imitées jusque dans leurs moindres détails. C’est « pour rire », mais ce peut être aussi comme une répétition générale de quelque chose qui semble encore impensable ou inespéré. Il ne faudra donc pas grand-chose, si les circonstances s’y prêtent, pour qu’à l’effigie succède celui-là même que l’effigie représentait, à savoir l’agent du pouvoir seigneurial et non plus sa simple figure. Les rituels symbolisent sans doute des événements, mais il arrive aussi qu’ils les produisent « pour de vrai », à travers ce que Bercé nomme alors « les fêtes changées en révoltes » :
« L’insurrection éclate pendant un jour de fête ; la réjouissance se change en prise d’armes. Aussi bien, l’émeute victorieuse s’achève en fête bachique et la foule danse après avoir mis en fuite ses ennemis. Plutôt que de passages évidents ou possibles de la fête à la révolte, il serait plus exact de parler d’échanges, car l’ambiguïté des récits empêche de dire le sens du passage, d’indiquer ce qui de la fête ou de la révolte précédait dans l’événement. Les voisinages de la tradition et de la violence, l’actualisation des débordements coutumiers, l’intrusion des tensions sociopolitiques dans le calendrier des fêtes, tout cela mérite un inventaire assez précis de cas, où l’on puisse faire le partage des rencontres fortuites ou bien des conséquences inéluctables d’un type de faits sur une autre catégorie de faits. Il s’agit, au fond, de s’interroger sur les rapports de la tradition instituée, ritualisée, avec l’événement, la chronique politique. »
Il n’y a peut-être rien de mieux qu’une fête traditionnelle — admise par tous, donc permise par le gouvernement — pour faire passer les désirs, voire les mots d’ordre d’un soulèvement. Pendant les deux siècles qui ont précédé la Révolution française, l’utilisation politique des fêtes est allée dans les deux sens contraires : pour asseoir ou pour déchoir le pouvoir en place. Par exemple, « l’apparition précoce, dans les carnavals des villes suisses, d’allusions politiques et d’allégories moralisatrices annonçait une rupture avec les fêtes traditionnelles » dans ce grand mouvement de la Réforme dont l’historien de l’art Aby Warburg aura étudié les « tracts » illustrés de monstres animaux. Bercé, quant à lui, a porté une attention éclairante sur les inversions de genres, lorsque les attributs du carnaval deviennent des emblèmes de révolte : ainsi, le 27 février 1630, dans la deuxième semaine du carême, fut aussi le premier jour d’un soulèvement des vignerons de Dijon, dont le meneur était vêtu, pour la circonstance, en roi de Mardi gras. Ailleurs, les émeutiers — comme le 26 février 1707 à Montmorillon, quand prenait également fin la période du carnaval — se déguisèrent en femmes, avec coiffe et jupon, armés de grands couteaux qui pouvaient encore dénoter l’art culinaire, mais qui, déjà, servaient d’armes à des fins de revendications sociales…
Et c’est ainsi que la fête engendre la violence agie, par un mouvement symétrique — une « inversion énergétique », aurait dit Warburg — au deuil éprouvé à la suite d’une violence subie. Mais la violence agit dans tous les sens : elle n’est ni une valeur ni une non-valeur en soi. Dans son livre Révoltes et révolutions dans l’Europe moderne, Bercé raconte suffisamment de cas pour que l’on comprenne la complexité des devenirs vers lesquels tout soulèvement est susceptible de bifurquer. Un soulèvement se lève : il jaillit, il déferle d’abord. C’est un événement extraordinaire, imprévisible. Mais après ? Après, il peut se disperser de lui-même, retomber tout seul comme les cendres d’un feu d’artifice. Ou bien il peut être écrasé par l’autorité qu’il avait trop spontanément contestée. Dans de nombreux cas, il finit par être canalisé, c’est-à-dire contenu, dévoyé, nié dans son jaillissement propre. Quand la révolte devient organisée ou hiérarchisée, cela veut souvent dire qu’elle est soumise à des fins d’appareils et qu’elle finit dans la soumission à un pouvoir, quel qu’il soit. Ou bien elle se perd à être dévoyée, orientée vers un but qui n’était pas le sien au départ.
On sait que dès 1903, lors des grands soulèvements en Russie, le ministre de l’intérieur du tsar, Viatcheslav Plehve, se fit fort de détourner la colère du peuple sur les communautés juives, de façon, disait-il, à « noyer la révolution dans le sang juif ». Ce fut l’époque sinistre où furent composés Les Protocoles des sages de Sion et où furent commis de terribles pogroms sous la férule des Centuries noires, ces milices d’extrême droite dont les SS allemands, plus tard, allaient imiter les pratiques (et même le fameux emblème de la petite tête de mort sur fond noir). Ce que décrit Bercé pour des périodes bien plus anciennes ne relève peut-être pas d’un tel cynisme ; en tout cas, les mêmes processus de détournement de la colère sont à l’œuvre lorsque à la souveraineté de la fête et à la légitimité de la révolte succède ce que Bercé nomme des phénomènes de boucs émissaires et de « xénophobie purificatrice », supposés assurer, dit-il, un « renforcement du sentiment de cohésion et d’identité collective » :
« Dans cette détermination purificatrice, des boucs émissaires, des pécheurs publics, comme l’étaient les gabeleurs, les usuriers ou les non-chrétiens, paraissaient des victimes désignées. Les étrangers, les juifs étaient donc les cibles privilégiées de tels déchaînements. La xénophobie atteignait des groupes socialement isolés, spectaculairement différents, facilement accessibles, et aussi favorisés économiquement, créanciers ou concurrents. L’annonce d’un malheur imputé à ce groupe (début d’épidémie, perte de navire, sacrilège) entraînait la vindicte populaire. La nouvelle de la prise de bateaux marseillais provoquait le massacre d’une ambassade turque séjournant alors à Marseille (20 mars 1620). Des matelots anglais étaient égorgés à Edimbourg en 1706 pour de semblables raisons. A Londres, la hantise d’un complot papiste suscitait périodiquement des chasses à l’Irlandais. Le petit peuple romain s’en prenait aux Espagnols accusés d’enlever des jeunes gens pour leurs armées. Un massacre de deux mille juifs à Lisbonne le 19 avril 1506 survint alors que la ville était menacée de peste. »
N’y aurait-il pas d’autres destins à la colère des peuples que la soumission d’un côté et le ressentiment de l’autre ? Il est vrai qu’un livre comme celui de Barrington Moore sur Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie incite à penser que les soulèvements ont indistinctement engendré le pire et le meilleur (17). Il est vrai, aussi, qu’entre 1792 et 1795 surgirent, dans tout l’ouest de la France, ce que Jacques Godechot a nommé des « insurrections contre-révolutionnaires » (18). Ou bien que les origines du fascisme, entre 1885 et 1914, se placent dans la perspective de ce que Zeev Sternhell (19) a rigoureusement nommé une « droite révolutionnaire » qui en appelait — comme le font aussi certains mouvements d’extrême gauche — à un soulèvement contre tout système démocratique, que ce soit sous la forme d’un coup d’Etat (comme dans le cas, étudié par Sternhell, des émeutes nationalistes de 1899 en France) ou de ce qu’Ernst Jünger nommera bientôt la « mobilisation totale », fondement de cette « révolution conservatrice » bien analysée, entre autres, par Enzo Traverso. Il est clair, à lire l’ouvrage récent d’Emilio Gentile Soudain, le fascisme, que la marche sur Rome peut se comprendre comme une authentique insurrection antiétatique immédiatement convertie en dictature fasciste.
Pas de mots magiques pour l’émancipation
Voilà, en tout cas, de quoi nous prévenir que les mots « soulèvement », « insurrection » ou « révolte » ne sauraient d’aucune façon donner des clefs — tels des mots magiques — pour tout ce qui touche aux désirs d’émancipation et, en général, à la constitution du champ politique. Nous sommes, là-dessus, bien loin du compte (la modestie sera donc de mise). Où va donc la colère ? C’est une question qui ne dépend pas unilatéralement de la puissance que son torrent déploie. C’est une question dialectique, ou qui en appelle à une réponse dialectique. Bertolt Brecht nous en donne un aperçu à la fois très simple et très subtil lorsque, dans son Journal de travail, il réfléchit — en date du 28 juin 1942 — sur ce paradoxe que « la haine n’est pas spécialement nécessaire pour la guerre moderne (20) ». Où va donc la colère dans les totalitarismes guerriers ? « Le fascisme, répond Brecht, est un système de gouvernement capable d’asservir un peuple à tel point qu’on peut abuser de lui pour en asservir d’autres. » Et n’allez pas me dire qu’il s’agit seulement d’histoires passées.
Georges Didi-Huberman
Philosophe et historien de l’art. Dernier ouvrage paru : Peuples en larmes, peuples en armes. L’œil de l’histoire, 6, Editions de Minuit, Paris, 2016.
(1) Claude Guillon, Notre patience est à bout. 1792-1793, les écrits des Enragé(e)s, IMHO, Paris, 2009.
(2) Peter Sloterdijk, Colère et temps. Essai politico-psychologique, Libella/Maren Sell, Paris, 2007.
(3) Philippe Raynaud et Stéphane Rials (sous la dir. de), Dictionnaire de philosophie politique, Presses universitaires de France, Paris, 2012 (1re éd. : 1996).
(4) Alain Rey, « Révolution » : histoire d’un mot, Gallimard, Paris, 1989.
(5) Jean Baechler, Les Phénomènes révolutionnaires, Presses universitaires de France, 1970.
(6) Vittorio Mathieu, Phénoménologie de l’esprit révolutionnaire, Calmann-Lévy, Paris, 1974.
(7) Daniel Cefaï, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, La Découverte-MAUSS, Paris, 2007.
(8) Haim Burstin, L’Invention du sans-culotte. Regard sur le Paris révolutionnaire, Odile Jacob, Paris, 2005.
(9) Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2008.
(10) Georges Bataille, « Sur Humanisme et terreur de Maurice Merleau-Ponty » (1947), Les Temps modernes, no629, Paris, novembre 2004 - février 2005.
(11) Michel Bakounine, Théorie générale de la révolution (1868-1872), Les Nuits rouges, Paris, 2008.
(12) Jules Vallès, L’Insurgé (Jacques Vingtras, III), Gallimard, 1975 (1re éd. : 1886).
(13) Yves-Marie Bercé, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Hachette Littérature, Paris, 1976, et Révoltes et révolutions dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles), CNRS Editions, coll. « Biblis », Paris, 2006 (1re éd. : 1980).
(14) Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie. Œuvres philosophiques complètes, I-1, Gallimard, 1977 (1re éd. : 1872).
(15) Florens Christian Rang, Psychologie historique du carnaval, Ombres, Toulouse, 1990 (1re éd. : 1909).
(16) Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, Gallimard, 1970.
(17) Barrington Moore Jr., Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie, La Découverte, 1983 (1re éd. : 1969).
(18) Jacques Godechot, La Contre-révolution. Doctrine et action, 1789-1804, Presses universitaires de France, 1961.
(19) Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Seuil, coll. « L’Univers historique », Paris, 1997 (1re éd. : 1976).
(20) Bertolt Brecht, Journal de travail (1938-1955), L’Arche, Paris, 1976.
Lire aussi le courrier des lecteurs dans notre édition de juin 2016
(20) Bertolt Brecht, Journal de travail (1938-1955), L’Arche, Paris, 1976.





















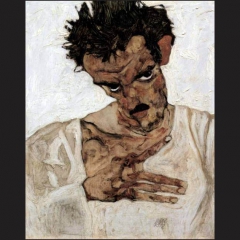
Les commentaires sont fermés.