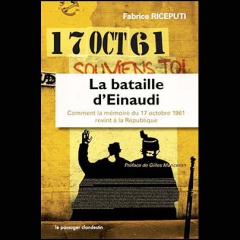La Bataille d’Einaudi
ou
Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République
de Fabrice Riceputi, préface de Gilles Manceron, éd Le passager clandestin, octobre 2015, 240 p., 15 €
Ci-dessous, un extrait de l’introduction (pages 23 à 26) de La bataille d’Einaudi.
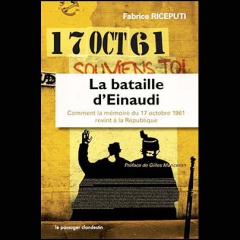
Pour reprendre l’expression d’un auteur britannique, la République gaullienne, en commettant ce crime, puis en le niant, avait fabriqué une « french memory’s bombe à retardement » [1]. Longtemps restée enfouie dans les tréfonds de la société française, cette bombe mémorielle explosa véritablement devant la cour d’assises de Bordeaux, trente-six ans plus tard. Ce 16 octobre 1997, une brèche s’est alors ouverte dans le mur de silence derrière lequel un consensus national avait si longtemps relégué le drame.Cette brèche ne s’est plus refermée. Au point, selon Henry Rousso, que le 17 octobre 1961, date du massacre d’Algériens pacifiques occulté durant trente ans, est devenu depuis les années 2000 une sorte de « métaphore métonymique » de la guerre d’Algérie, « sale guerre » coloniale dont on dissimula les nombreux crimes. Son abondante commémoration dans les media à chaque anniversaire, une production très importante de livres et de films d’histoire ou de fiction le prenant pour objet depuis les années 2000, font qu’après une longue « amnésie », on pourrait désormais parler, selon lui, d’une « hypermnésie » [2] : l’événement longtemps occulté aurait désormais une place pour ainsi dire disproportionnée dans la mémoire collective.Quoi qu’il en soit, ce retour fracassant doit sans conteste beaucoup à un homme, Jean-Luc Einaudi. C’est ce combat pour la connaissance historique et pour la reconnaissance politique d’un crime raciste colonial d’État que ce livre entend retracer. Un combat qui s’étendit sur trois décennies.La fameuse déposition d’Einaudi à Bordeaux n’en fut que l’épisode le plus connu. Commencé dès le milieu des années 1980, ce combat fut d’abord celui que Jean-Luc Einaudi mena en solitaire pour parvenir à dresser le procès-verbal du massacre dans La bataille de Paris. Il s’agissait en somme de redonner « un nom et une adresse » à un crime d’État nié officiellement et devenu depuis une sorte de rumeur mémorielle, un événement sans historien ni histoire.Puis survint la double confrontation judiciaire avec Maurice Papon. Cette confrontation, Einaudi l’avait en quelque sorte lui-même engagée dès la première page de son livre. Il avait en effet conjointement dédié ce dernier à deux enfants victimes de ce serviteur de l’État, l’une juive, Jeannette Griff, 9 ans, déportée en 1942 de Bordeaux à Drancy avant de l’être à Auschwitz [3], l’autre « française musulmane d’Algérie », Fatima Bedar, 15 ans, noyée dans le canal Saint-Denis en octobre 1961 [4] Bien que seul le premier de ces deux crimes ait pu être jugé par la Cour d’asises de Bordeaux en 1997, le second fut finalement examiné lors d’un autre procès retentissant en 1999. Étrangement, c’est au cours de ce procès intenté par Maurice Papon lui-même à Jean-Luc Einaudi que la justice reconnut « un massacre ».Mais, si c’est par lui que la France redécouvrit véritablement le 17 octobre 1961, la bataille ne se réduisit pas, comme nous le verrons, à ce mano a mano finalement victorieux avec l’ancien préfet de police de Paris, qui fit les délices de la presse et personnifia à l’excès le débat historique. Einaudi ne fut pas seulement celui qui « défia Maurice Papon ». En effet, une fois défaite et ruinée la version officielle de 1961, restait encore à faire plier la raison d’État qui refusait la vérité. Il fallait notamment affronter la résistance acharnée de l’appareil d’État lui-même à livrer ses archives. Le combat pour obtenir leur ouverture sur le 17 octobre contribua à une libération de la recherche sur la guerre d’Algérie. Mais la même raison d’État fit deux victimes trop souvent oubliées : deux archivistes, Philippe Grand et Brigitte Lainé. Ces deux là payèrent chèrement un héroïsme bien ordinaire : le simple fait d’avoir, en défense d’Einaudi face à Papon, témoigné de ce qu’ils savaient, en tant qu’archivistes, devant la justice. Leur ahurissante « affaire » est également racontée ici.Enfin, la bataille d’Einaudi porta en elle une exigence politique dont l’enjeu fut et est encore considérable. Elle touche à l’identité même de la France d’hier, mais aussi d’aujourd’hui : celle d’une reconnaissance officielle, d’une intégration à « l’histoire de France » d’un massacre colonial et raciste hautement emblématique de ce que fut la République coloniale. La France, selon une formule tant de fois employée depuis les années 1990, allait-elle enfin « regarder en face son passé colonial » et en tirer les leçons en s’attaquant à un impensé colonial toujours à l’œuvre ?Cette exigence heurtait de front un consensus français majeur, formé dès la guerre d’Algérie entre les principales forces politiques de la Ve République pour maintenir l’omerta, sur ce crime colonial-là comme sur tous les autres. Ce pacte du silence ne fut rompu qu’en 2012, le plus haut sommet de l’État admettant enfin, mais du bout des lèvres, qu’« une tragédie » avait eu lieu le 17 octobre. Einaudi considéra alors que son combat était largement victorieux. L’« amnésie » proprement dite était bel et bien vaincue. Mais il savait que si la République consentait désormais, contrainte et forcée, à compatir à la « douleur des victimes » de certains crimes coloniaux, elle s’arrêtait toujours, comme frappée d’aphasie, au seuil de la vérité la plus difficile à admettre, celle des responsabilités politiques.
Notes
[1] Cette formule, titre d’un article de Richard J. Golsan (« Memory’s bombes à retardement. Maurice Papon, crimes against humanity and 17 october 1961 », Journal of European Studies, voL. 28, n° 109-110, 1998, p. 153-172) est citée dans Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire (Paris, Tallandier, 2008), remarquable somme sur la répression de l’automne 1961 et son histoire mémorielle, abondamment utilisée pour écrire ce livre.
[2] Henry Rousso, « Les raisins verts de la guerre d’Algérie », in Yves Michaud (dir.), La Guerre d’Algérie (1954-1962), Paris, Odile Jacob, 2004, p. 127-151.
[3] Arrêtés en gare de Mont-de-Marsan le 18 août 1942, Jeannette Griff, ses trois jeunes frères et sa mère sont morts à Auschwitz le 9 septembre 1942 (voir site internet du MRAP des Landes : www.mrap-landes.org/spip.php ?article561).
[4] Sur Fatima Bedar, voir Jean-Luc Einaudi, Octobre 1961. Un massacre à Paris, Arthème Fayard/Pluriel, 2011 (réed.), p. 471-474, ainsi que Didier Daenninckx, « Fatima pour mémoire », Mediapart, 22 septembre 2011 (www.mediapart.fr/journal/fra...).
![]() Facebook
Facebook