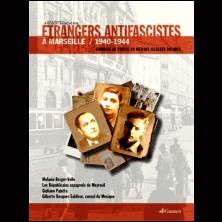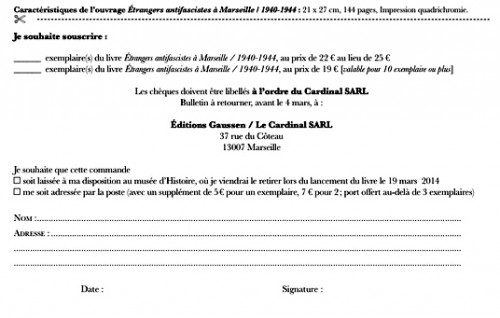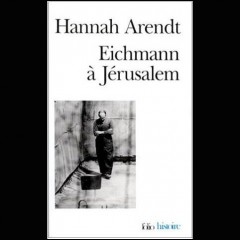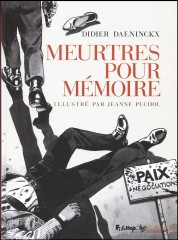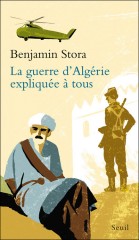Sur le front économique, avec ses retombées « sociales », ce n’est pas un « recul », comme le déplorent des « observateurs » dont les intentions sont aussi bonnes que la vue est courte, mais une offensive néo-libérale tous azimuts qui vient renforcer, depuis les hautes sphères étatiques, celle que mène la bourgeoisie transnationale depuis les années 1970.
Dès novembre 2012, un « pacte de compétitivité » avait été mis sur orbite, que François Hollande plaçait sans rire sous le signe d’un « socialisme de l’offre » alors qu’il s’agissait d’un pacte avec le capital aux dépens des travailleurs à qui l’on n’offrira que de nouvelles amputations à leur pouvoir d’achat. En guise de justification, ils auront droit à une trilogie, qui va leur être resservie tout au long des mois suivants : résorption de la dette, diminution des dépenses publiques et restriction budgétaire. Sauf pour les entrepreneurs, qui vont bénéficier de « cadeaux » en tous genres, à faire rituellement pousser des cris d’orfraies à la CGT, aux journalistes de L’Humanité et au leader du Parti de gauche. L’argumentation est toujours la même : il faut d’abord « relancer l’économie ». Pour ce qui est de la redistribution, on verra plus tard. C’est-à-dire aux calendes grecques.
En septembre 2013, François Hollande inaugure son septennat en faisant ratifier le traité européen de discipline budgétaire puis la loi organique mettant en œuvre l’inique « règle d’or » de retour à l’équilibre des finances publiques, qu’il avait longtemps vitupérée, en croyant tempérer cette capitulation par un additif dérisoire sur la « croissance ». En janvier 2013, un accord national interprofessionnel (ANI), dit de « sécurisation de l’emploi », est signé par les syndicats patronaux et trois syndicats minoritaires de salariés, que le gouvernement, appuyé par son parti godillot mais aussi par les parlementaires de l’UMP et du Modem, s’efforcera tout au long de l’année de transposer en loi. Un « compromis historique » à la mode « hollandaise » qui avait pour but, en réalité, de « flexibiliser le marché du travail » au profit des entreprises et, plus largement, de parachever la mise en pièces du droit du travail.
L’année 2014 a démarré sur les chapeaux de roue en matière d’austérité avec le « pacte de responsabilité », qui réduit une nouvelle fois les charges pesant sur les entreprises. D’ici 2017, 30 milliards d’euros par an seront alloués à la baisse du « coût du travail », en incluant les 20 milliards déjà accordés dans le cadre du crédit d’impôt compétitivité emploi (Cice). Un pacte accueilli d’autant plus favorablement par le Medef que celui-ci en était l’inspirateur. De fait, cette nouvelle baisse des charges, associée à la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier 2014, sert de substitut à une dévaluation, rendue impossible par l’euro. François Hollande met ainsi en branle la « TVA sociale » que Nicolas Sarkozy proposait en 2007 mais qu’il n’avait pas voulu ou osé mettre en œuvre durant son quinquennat.
À ce bilan provisoire de la gauche de gouvernement, globalement positif pour le capital, on pourrait évidemment ajouter les privatisations, dans la lignée du gouvernement de Lionel Jospin qui, aidé du ministre de l’Économie et des finances Dominique Strauss-Kahn, avait battu tous ceux de droite dans ce domaine. Mentionnons, au crédit ou au débit du tandem Hollande-Ayrault et de leurs compères « socialistes », quelques privatisations partielles : la cession en deux fois d’environ 8 % du capital de Safran, de 3,66 % du capital d’EADS, de 9,5 % du capital d’Aéroport de Paris puis, la dernière en date officiellement répertoriée, de 1 % du capital d’Airbus Group (anciennement EADS). On peut aussi aussi évoquer la déclaration de Arnaud de Montebourg en avril 2013 en faveur d’une diminution la participation de l’État dans certaines entreprises, sans les nommer, telles EDF et GDF-Suez. Une intention publiquement relayée par Jean-Marc Ayrault un mois plus tard.
On objectera peut-être que le résultat est assez maigre comparé aux prouesses de Jospin et de DSK. Mais ceux-ci étaient d’autant plus difficiles à concurrencer qu’il ne restait pas grand chose à grignoter en 2012 pour le secteur privé. Encore qu’il ne faille pas oublier la privatisation rampante des services publics qui, elle, continue d’aller bon train. De la Poste à la SNCF « modernisées » aux hôpitaux « rationalisés » et à la « Sécu » semi privatisée de facto par la généralisation obligatoire de la complémentaire de santé pour tous les salariés ; en passant par l’Université, où la loi Fioraso, dans le prolongement de la LRU, vise à créer un véritable marché concurrentiel de l’enseignement supérieur et à en faire un sous-traitant de la recherche et du développement des entreprises privés, tout en fournissant au patronat local, par la généralisation de l’alternance, une main-d’œuvre docile et à bas coût. Ainsi Hollande et ses séides n’ont-ils pas ménagé leur peine pour continuer à transformer les usagers des services publics en « clients ».
« J’ai toujours soutenu l’approche de François Hollande sur toutes les question économiques et sociales car c’est une approche de dialogue, de concertation réelle », se félicitera Laurence Parisot en juin 2013 au moment où le gouvernement s’apprêtait à faire reculer l’âge de la retraite et allonger la durée des cotisations ; « réforme » devant laquelle Sarkozy avait reculé par crainte de voir les salariés descendre une nouvelle fois dans la rue, encore plus nombreux et plus « remontés ». L’ancienne présidente du MEDEF avait effectivement de quoi se réjouir. Reste à savoir si les réjouissances dont la deuxième droite ne cesse de régaler le patronat depuis son retour au pouvoir pourront durer éternellement.
À force de voguer toutes voiles dehors sur « les eaux glacées du calcul égoïste » (comme aurait dit Marx), celui de l’actionnariat mondial en l’occurrence, le « capitaine de pédalo » pourrait bien finir un jour par entrer dans la « zone des tempêtes » promises par Jean-Luc Mélenchon. À la longue, en effet, le durcissement continuel des conditions de vie des travailleurs et des chômeurs, auxquels on peut ajouter la situation d’une jeunesse sans avenir et de retraités désespérés, risque de provoquer de plus en plus de remous. Exaspérées par la collusion avec les capitalistes de ce qu’il faut bien appeler une « deuxième droite », lassées par des grèves et des manifestations à répétition et sans résultats, une partie des classes populaires pourraient en venir à choisir la voie de l’illégalisme pour exprimer leur refus et même entrer en résistance. En se mettant à bloquer les rues, à lancer des projectiles sur la police, à encercler et occuper des édifices officiels ou à en brûler d’autres pour se faire entendre des autorités restées sourdes à leurs protestations et revendications pacifiques.
D’où une question : la montée probable de la défiance voire de l’hostilité populaires vis-à-vis des « élites » au pouvoir peut-elle déboucher sur l’ouverture d’une période pré-insurrectionnelle ? Sans doute est-ce là, de la part de ce qui reste de la gauche progressiste, prendre ses désirs pour la réalité. Il semble toutefois que les gouvernants actuels, chargés, comme le veut la mission « régalienne » de l’État, toutes couleurs politiciennes confondues, de préserver l’« ordre public », autrement dit l’ordre social, n’écartent pas non plus cette hypothèse. Incarnée par le locataire actuel de la place Beauvau, la politique menée sur le front intérieur fait, en tout cas, encore monter d’un cran la criminalisation à laquelle recouraient ses prédécesseurs à l’égard des plus faibles ou des plus récalcitrants.
L’hystérie répressive de Manuel Valls, tout d’abord, vaut largement celle de Nicolas Sarkozy quand il occupait la même fonction. Et pour la même raison : jouer la carte sécuritaire pour accéder à la charge supême. Mais, au-delà ou en-deçà des ambitions personnelles, c’est la mise en place d’un État où l’exception, en matière de répression, tend à devenir la règle, que la deuxième droite poursuit avec une ardeur que pourrait lui envier la première.
Passons rapidement sur les expulsions de sans-papier, de Roms ou de squatteurs. Le palmarès de Manuel Valls, à cet égard, mais aussi de certains maires de la fausse gauche, Front de gauche compris, vaut largement celui de Brice Hortefeux ou de Claude Guéant et des maires de la vraie droite. Et les discours de légitimation à connotations ouvertement racistes accompagnant ce nettoyage socio-ethnique aussi. Qu’on se souvienne, l’exemple venant des sommets de l’État, de Manuel Valls déambulant entre les étalages d’une brocante populaire dans sa commune d’Évry pour déplorer « l’image que ça donne de la ville » renvoyant aux marchands et aux clients d’origine africaine ou maghrébine. Et le ministre de l’Intérieur de suggérer, dans la foulée, sur le mode de la plaisanterie, qu’on y mette, pour améliorer cette image, « plus de blancs, de white, de blancos ». Ou le même expliquant que les Roms « ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation», et qui donc « ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ». Des propos qui lui valurent une plainte du MRAP pour incitation à la haine raciale, classée sans suite, comme il faillait s’y attendre.
Aujourd’hui comme hier, cependant, l’ennemi principal demeure, pour le moment, le « racailleux de cité ». Comme de coutume, la deuxième droite se devait de surenchérir sur la première quant aux moyens de le neutraliser. À peine constitué, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault annonçait durant l’été 2012 la création de « zones de sécurité prioritaire » (ZSP), territoires recouvrant les territoires urbains jugés les plus « sensibles », qui « bénéficieront » à ce titre d’un quadrillage renforcé par des gendarmes ou des policiers supplémentaires. En novembre de la même année, Manuel Valls en rajoutait une louche avec l’ajout de 49 nouvelles ZSP. Et pour terminer l’année 2013 en beauté, ce sont 19 autres qui viendront le 11 décembre compléter le lot.
Imputer au seul Manuel Valls cette pulsion sécuritaire serait néanmoins à la fois injuste et erroné. Il est parfaitement représentatif de la mentalité des caciques du PS confrontés aux désordres générés par leur propre soumission au nouvel ordre néolibéral. Ainsi les candidats « socialistes » à la succession de Jean-Claude Gaudin à la tête de la municipalité profiteront-ils de la campagne des primaires au sein du parti, en septembre 2013, pour montrer qu’en matière de « sûreté urbaine » ils n’avaient pas de leçons à recevoir de l’UMP et encore moins du FN. La sénatrice PS Samia Ghali « élue des quartiers Nord (mal famés) mais résidant dans les quartier Sud (très huppés) » avait déjà défrayé la chronique marseillaise en réclamant l’intervention de l’armée dans les cités. Le 12 septembre 2013, lors d’un débat télévisé sur France 3, Eugène Caselli, président « socialiste » de Marseille Provence métropole (élu avec les voix de la droite), demandera à Manuel Valls de placer la totalité de Marseille en ZSP. Le même proposera quelques jours plus tard de faire survoler et surveiller les quartiers Nord par des drones pour mettre un frein, à défaut d’y mettre fin, au lucratif mais meurtrier trafic de stupéfiants : « Je demande à l’État de faire de Marseille un véritable laboratoire contre le crime, un laboratoire avec de nouveaux moyens technologiques. Maintenant, on a des drones, et on va s’en servir. » Très en retard sur ses concurrents dans les derniers sondages, il remettra peu après le couvert dans La Provence : « C’est tout à fait sérieux et d’ailleurs, ça se fait à Mexico. »
Bien que gardé à vue quelque temps auparavant dans un dossier de marchés publics, ce notable assénait : « Pas de mansuétude pour les délinquants ! » Comme Samia Ghali, il a grandi dans l’ombre d’un autre partisan de l’utilisation des drones : Jean-Noël Guerini, parrain du PS local, mis en examen pour prise illégale d’intérêts, trafic d’influence et association de malfaiteurs mais toujours président de Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui serait en train de « réfléchir à la mise en place de moyens aériens de surveillance, avions ou drones ». Une idée appuyée également par d’autres ténors du PS marseillais, dont Patrick Menucci, qui se voit déjà trônant à la mairie. La mafia « socialiste », en somme, pour lutter contre le crime ! Marseille, il est vrai, en a vu d’autres.
Autre innovation dans le genre militaro-policier, mais sur terre cette fois-ci, qu’on doit à la deuxième droite revenue au pouvoir, l’« opération César », menée tambour battant en octobre 2012 contre les opposants à la construction de l’aéroport des Landes. Faut-il voir dans cet intitulé un rapport avec la fameuse déclaration césarienne, « Veni, vidi, vinci », ironisait un journaliste ? Elle offre en tout cas un avant-goût de ce qu’il en coûterait à tous ceux qui s’aviseraient, y compris par des moyens non violents, de faire obstacle aux plans et aux programmes mis-en-œuvre pour faire fructifier en France un capitalisme en quête de « croissance », celui du groupe de BTP Vinci en l’occurrence. Squatteurs évacués « sans ménagement » (pour reprendre l’euphémisme habituel de la presse de marché pour masquer la brutalité policière), habitations détruites, terrains agricoles saccagés, etc. Tout cela sans qu’il soit besoin d’instaurer officiellement un quelconque état d’urgence, comme avait pris soin de le faire Dominique de Villepin lors des émeutes de banlieue de novembre 2005. Les commissaires enquêteurs mandatés sur la zone n’avaient pas encore remis leur rapport, les juges d’expropriation n’avaient pas fini de statuer à propos des propriétaires à indemniser, le financement du projet n’était pas bouclé. Peu importe : l’« État de droit », même régi par ce qu’on persiste à dénommer « la gauche », reste plus que jamais un État de droite. Les juristes et les politologues ont beau lui reconnaître un « monopole de la violence légitime », il n’empêche que cette violence étatique supposée être « basée sur la conformité au droit et à l’équité – mais pas à l’égalité, ne rêvons pas ! – achève de perdre toute légitimité sous le règne de la gauche gouvernante.
Pour convaincre, non pas les électeurs qui avaient voté pour lui, mais les représentants du capitalisme globalisé, que « le changement » c’était vraiment « maintenant », il ne restait plus à Hollande qu’à conjuguer une politique intérieure régressive avec une politique extérieure de va-t-en guerre, qui lui permettrait de s’ériger en défenseur encore plus résolu que Sarkozy du nouvel ordre mondial. Pour ce faire, le « capitaine de pédalo » va troquer le costume de marin virtuel dont on l’avait affublé pour le treillis et les rangers.
Coup sur coup, avec à ses côtés Jean-Yves Le Drian, qui avait fait ses preuves sous Mitterrand en matière de néo-colonialisme armé, il lancera deux expéditions guerrières en Françafrique, l’une au Mali et l’autre en Centrafrique, pour y maintenir la présence française et surtout celle des firmes hexagonales qui exploitent les ressources et les travailleurs des pays concernés. Quant aux prétextes avancés pour légitimer ces opérations, il n’avait pas eu à les chercher bien loin puisqu’ils sont devenus monnaie courante depuis la fin de la guerre froide pour justifier le redéploiement impérialiste : la lutte contre le terrorisme et la protection des population civiles.
Le pré-carré africain était semble-t-il trop étroit pour Hollande. Afin d’être à la hauteur du rôle qu’il entendait être le sien sur la scène internationale et pour compenser par des exploits diplomatiques voire militaires l’impression de médiocrité que donnait sa soumission répétée aux diktats des « marchés », il n’hésitera pas à jouer les fauteurs de guerre au Proche et Moyen Orient. Pour torpiller les négociations avec les régimes syrien et iranien, il fera appel à un expert, Laurent Fabius, qui s’était illustré par le passé dans l’« affaire du sang contaminé » et le lancement de la politique de « rigueur », la seconde encore plus mortifère, si l’on en juge au nombre de leurs morts prématurées. « Bachar el Assad ne mérite pas d’être sur terre », décrétera le ministre des Affaires étrangères « socialiste » qui, outre que les critères pour en décider pourraient s’appliquer à bon nombre de gouvernants, semblait ignorer qu’on était en droit d’en dire autant de lui. Dans sa fuite en avant belliciste, Hollande n’hésitera pas à se commettre avec les pétromonarchies répressives et corrompues suivant la tradition de ses prédécesseurs, de la première comme de la deuxième droite.
Devant pareil désastre eu égard à l’idée qu’on pouvait se faire de la gauche en France mais aussi à l’étranger, associée pendant longtemps à celle d’émancipation collective, la consternation pourrait l’emporter. « Que faire ? », pourrait-on dès lors se demander comme l’avait fait Lénine. À la différence près que nulle perspective de révolution ne s’inscrit aujourd’hui à l’horizon. Plutôt que de tirer des plans sur la comète « utopie », il semble qu’il faille, en attendant mieux, suivre sans plus tarder le conseil de Manuel Valls de débaptiser le PS. Non pas, comme il l’avançait en 2007, « parce que le mot “socialiste” ne veut plus rien dire », mais pour mettre un terme à une imposture qui n’a que trop duré, et faire dire à nouveau à ce mot ce qu’il pu signifier pour les classes dominées : une alternative à l’ordre des choses existant.
Jean-Pierre Garnier (28 mars 2014 )
Lire la suite de cette chronique
Cette chronique est initialement parue en avril 2014 dans Les Z’Indignés.
Du même auteur sur le même thème, La Deuxième droite (avec Louis Janover), Agone, 2013.