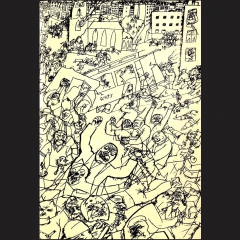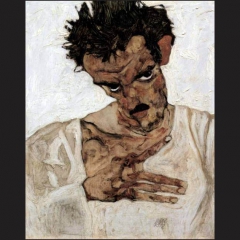« La violence de la fraternité », le dernier discours de Malcolm X
Le 16 février 1965, Malcolm x, l’un des plus grands militants et activistes afro-américain, livrait ce qui sera son dernier discours. Cinq jours plus tard, il fut assassiné à Harlem.
Ce dernier discours fut prononcé à l’église méthodiste de Corn Hill Rochester de New York. Malcolm X y parle ouvertement de la relation complexe entre la France et les noirs français : discours encore terriblement d’actualité aujourd’hui dans un climat où les médias français dépeignent une image peu flatteuse des immigrés et fils d’immigrés français. Le célèbre activiste met le doigt sur un sujet épineux : Il existe certes, une haine des blancs envers les noirs, mais il est aussi essentiel de prendre conscience de la haine des noirs envers eux même, véhiculée par la culture blanche...

Malcom X & Martin Luther King
« Avant toute chose, mes frères et sœurs, je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps de venir ici ce soir, à Rochester, et surtout de m’avoir invité, à cette petite tribune informelle pour débattre de préoccupations communes à tous les membres de la communauté, de la communauté de Rochester dans son ensemble. Si je suis ici, c’est pour parler avec vous de la révolution Noire, en marche sur cette terre, des formes qu’elle prend sur le continent africain et de son impact sur les communautés noires. Non seulement ici, en Amérique, mais aussi aujourd’hui en Angleterre, en France, et dans toutes les anciennes puissances coloniales.
La plupart d’entre vous ont sans doute appris par la presse, la semaine dernière, que j’avais pris la peine d’aller à Paris et qu’on m’avait éconduit. Or Paris n’éconduit personne. Comme chacun sait, qui veut est supposé pouvoir se rendre en France ; ce pays a la réputation d’être très libéral. Pourtant, la France connaît des problèmes dont elle n’a pas fait grand étalage. L’Angleterre aussi, connaît des problèmes dont elle n’a pas fait grand étalage, parce que l’Amérique elle, étale ses problèmes. Mais ces trois partenaires, ces trois alliés, rencontrent aujourd’hui des difficultés communes, dont les Noirs américains, les Afro-américains, n’ont pas vraiment idée.
Afin que vous et moi connaissions la nature de la lutte dans laquelle vous et moi sommes engagés, nous devons connaître les différents éléments qui entrent en jeu, au niveau local et national, mais aussi sur le plan international. Les problèmes de l’homme Noir ici, dans ce pays, aujourd’hui, ne sont plus seulement le problème du Noir Américain, ou un problème Américain. C’est un problème devenu si complexe, aux implications si nombreuses, qu’il faut le considérer dans son ensemble, dans le contexte mondial ou international, afin de bien le voir tel qu’il est en réalité. Sinon, vous ne pouvez même plus prendre la mesure des problèmes locaux, à moins d’en saisir la portée dans le contexte international tout entier. Et quand vous l’observez en contexte, il vous apparaît sous un jour nouveau, mais avec plus de clarté.
Vous devriez vous poser cette question : pourquoi un pays comme la France devrait autant s’inquiéter de la venue d’un pauvre petit Noir américain, au point qu’elle lui en interdise ses frontières, quand tout un chacun ou presque peut s’y rendre quand bon lui semble ? C’est avant tout parce que ces trois pays font face aux mêmes problèmes. Or le problème est précisément celui-ci : dans l’hémisphère Ouest, vous et moi n’en avons pas pris conscience mais, nous ne formons pas précisément une minorité sur cette terre. Sur ce continent, il y a les … c’est le peuple brésilien, dont les deux-tiers ont la peau foncée, comme vous et moi. Ce sont les Africains par leurs origines, Africains sont leurs ancêtres ; Africain est leur passé. Et pas seulement au Brésil, mais à travers toute l’Amérique Latine, les Antilles, les États-Unis et le Canada, vous avez des gens d’origine africaine.
Beaucoup d’entre nous se pourvoient en imaginant que seuls sont afro-américains ceux qui se trouvent aux États-Unis… l’Amérique, c’est l’Amérique du Nord, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud. Quiconque a des ancêtres africains en Amérique du Sud, est afro-américain. Quiconque en Amérique Centrale a du sang africain, est afro-américain. Quiconque ici, en Amérique du Nord y compris au Canada, est afro-américain s’il a des ancêtres africains… et même jusqu’aux Antilles, c’est un Afro-américain. Quand je parle des Afro-américains, je ne parle pas seulement des vingt-deux millions d’entre-nous qui sommes ici, aux États-Unis. Les Afro-américains, c’est ce grand nombre d’être humains de l’hémisphère Ouest, depuis l’extrême sud de l’Amérique du Sud, jusqu’à la pointe la plus au Nord de l’Amérique du Nord. Tous ont un héritage commun, une origine commune, quand vous remontez jusqu’à leurs racines.
Aujourd’hui, il existe quatre sphères d’influence dans l’hémisphère Ouest, que subit le peuple noir. II y a l’influence espagnole, héritage du passé colonial de l’Espagne sur une partie du Continent. Il y a l’influence française qui concerne la région qu’elle a autrefois colonisée. La région que les britanniques ont autrefois colonisée. Et puis ceux d’entre nous qui sommes ici, aux États-Unis (…)
A cause de la mauvaise santé économique de l’Espagne, et parce qu’elle a perdu sa position prédominante sur la scène mondiale en termes d’influence, très peu de gens de peau noire ont émigré en Espagne. En revanche, le niveau de vie élevé en France et en Angleterre a poussé nombre de Noirs à émigrer des Antilles anglaises en Grande-Bretagne, et nombre de Noirs des Antilles françaises à émigrer en France, et puis vous et moi, déjà ici.
Ça signifie donc que les trois grands alliés, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont un problème aujourd’hui, un problème commun. Mais on ne nous a jamais donné suffisamment d’informations, ni à vous, ni à moi, pour comprendre qu’ils avaient un problème commun. Et ce problème commun, c’est ce nouvel état d’esprit qui est reflété dans la complète division du peuple Noir, en France métropolitaine, en Angleterre et ici, aux États-Unis. Et ce… c’est état d’esprit a évolué au même rythme que les transformations dans les mentalités, sur le continent africain. Donc, quand vous considérez le processus de la révolution africaine et par révolution africaine je veux dire que l’émergence des nations africaines dans l’indépendance qui a lieu depuis les dix ou douze dernières années, a absolument affecté l’état d’esprit des Noirs en occident. A tel point que lorsqu’ils émigrent en Angleterre, ils posent des problèmes aux anglais. Et lorsqu’ils émigrent en France, ils posent des problèmes aux français. Et quand ils… déjà ici aux États-Unis… mais une fois qu’ils s’éveillent, ce même état d’esprit se reflète chez l’homme Noir, aux États-Unis, alors il pose un problème à l’homme blanc, ici en Amérique.
Et ne pensez pas que le problème du blanc en Amérique soit unique. La France a le même. La Grande-Bretagne a le même. Mais la seule différence entre la France, la Grande-Bretagne et nous, c’est que de nombreux leaders Noirs se sont levés ici à l’Ouest, aux États-Unis, et ont créé une sorte d’engagement (militancy) qui a effrayé les américains blancs. Mais ça n’a pas eu lieu en France ou en Angleterre. Ce n’est que récemment que la communauté noire américaine et la communauté anglaise des Antilles, ainsi que la communauté africaine en France ont commencé à s’organiser entre elles. La France meurt de peur. C’est le même phénomène en Angleterre. Jusqu’à … très récemment, c’était la désorganisation complète. Et c’est seulement depuis peu qu’en Angleterre, les Antillais, la communauté africaine et les Asiatiques, ont commencé à s’organiser et à travailler en coordination et en étroite collaboration. Et cela a posé un problème très sérieux à l’Angleterre.
Il me fallait exposer cette situation afin que vous compreniez quelques-uns des problèmes actuels qui se développent ici sur cette terre. Et vous pouvez rapidement comprendre les problèmes entre les Noirs et les Blancs ici à Rochester, entre les Noirs et les Blancs du Mississippi, et entre les Noirs et les Blancs de Californie, à moins que vous ne compreniez le problème fondamental entre Noirs et Blancs… non limité à l’échelle locale, mais au niveau international et de la planète toute entière aujourd’hui. Si vous essayez de le considérer dans cette perspective, vous comprendrez. Mais si vous essayez uniquement de l’appréhender dans sa dimension locale, vous ne le comprendrez jamais. Vous devez considérer la tendance qui se dessine sur cette terre. Et le but de ma venue ici ce soir, est de vous en donner une vision aussi actuelle que possible.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai quitté le mouvement des Black Muslims, et pendant l’été, j’ai passé cinq mois au Moyen-Orient et sur le continent africain. Pendant cette période, j’ai visité de nombreux pays dont le premier a été l’Égypte, puis l’Arabie, puis le Koweit, le Liban, le Soudan, le Kenya, l’Éthiopie, Zanzibar, le Tanganyika – qui s’appelle aujourd’hui la Tanzanie – le Nigeria, le Ghana, la Guinée, le Liberia, l’Algérie. Et pendant ces cinq mois, j’ai eu la chance de discuter longuement avec le président Nasser en Égypte, le président Julius Nierait en Tanzanie, Jomo Kenyatta au Kenya, Milton Obote en Ouganda, Azikiwe au Nigeria, N’krumah au Ghana et Sékou Touré en Guinée. Les nombreuses informations échangées avec les hommes et d’autres africains, sur ce continent, au cours de ces entretiens, ont élargi ma compréhension et, je le sens, mon acuité intellectuelle. Car, depuis mon retour, je n’ai eu aucun désir d’aucune sorte de me retrouver embourbé dans quelque querelle stérile avec des cervelles d’oiseaux, des esprits étroits qui font partie d’organisations. On y débat de faits trompeurs et qui ne mènent nulle part quand on essaie de trouver des solutions à des problèmes aussi complexes que le nôtre.
Je ne suis pas ici ce soir pour parler de certains de ces mouvements qui sont en désaccord total les uns avec les autres. Je suis ici pour vous parler du problème auquel nous sommes tous confrontés. Et pour avoir… et pour le faire de façon très informelle. Je n’aime pas être tenu à être formel dans ma méthode ou ma façon de procéder, lorsque je m’adresse au public, parce que je trouve qu’habituellement la conversation dans laquelle je m’engage tourne autour des problèmes de race ou de choses raciales, ce qui n’est pas de ma faute. Je n’ai pas créé le problème de race. Et vous le savez, je ne suis pas venu en Amérique sur le Mayflower ou de mon propre gré. Notre peuple a été conduit ici malgré lui, contre notre volonté. Donc, si nous posons le problème maintenant, ils ne devraient pas nous blâmer d’être ici. Ils nous ont amenés ici. (Applaudissement) (…).
Pour défendre ma propre position, tout comme je l’ai fait plus tôt aujourd’hui à Colgate, je suis Musulman, ce qui signifie simplement que ma religion est l’Islam. Je crois en Dieu, l’Être Suprême, le Créateur de l’Univers. C’est une forme de religion très simple, facile à comprendre. Je crois en un Dieu unique. Et c’est simplement bien mieux comme ça. Mais je crois en un Dieu et je crois que ce Dieu avait une religion, a une religion et aura toujours une religion. Et que ce Dieu enseigna la même religion à tous les prophètes, il n’y a donc pas à se quereller à propos de qui était le plus grand, ou qui était le meilleur : Moïse, Jésus, Mahomet, ou quelques autres. Tous étaient des prophètes et venaient d’un seul Dieu. Ils avaient une doctrine, et cette doctrine était conçue pour apporter la lumière sur l’humanité, de telle sorte que toute l’humanité pouvait voir qu’elle était Une et partager une sorte de fraternité qui pourrait être vécu ici sur cette terre. Je crois en cela.
Je crois en la fraternité des hommes. Mais en dépit du fait que je crois en cette fraternité, je dois être réaliste et comprendre qu’ici, en Amérique, nous sommes dans une société qui ne connaît pas la fraternité. Elle n’applique pas ce qu’elle prêche. Elle prêche la fraternité, mais ne l’applique pas. Et parce que… cette société n’applique pas la fraternité, ceux d’entre nous qui sont musulmans – ceux d’entre nous qui ont quitté le mouvement des Black Muslims et se sont regroupés en tant que Musulmans, dans un mouvement fondé sur l’Islam orthodoxe… nous croyons en la fraternité de l’Islam.
Mais nous comprenons aussi que le problème auquel sont confrontés les Noirs de ce pays est si complexe et si difficile, existe depuis si longtemps sans solution, qu’il nous est absolument nécessaire de former une autre organisation. Ce que nous avons fait, sous la forme d’une organisation non religieuse dans laquelle… est connue comme étant l’Organisation de l’Unité afro-américaine, et dont la structure est organisée de manière à permettre une participation active de tout Afro-américain, tout Noir américain, selon un programme conçu pour éliminer les maux politiques, économiques et sociaux auxquels notre peuple est confronté dans la société. Et nous avons mis cela en place parce que nous comprenons que nous devons nous battre contre les maux d’une société qui a échoué à créer la fraternité pour chaque membre de cette société. Ceci ne veut en aucun cas dire que nous sommes anti-blancs, anti-bleus, anti-verts ou antijaunes. Nous sommes anti-Mal. Anti-Discrimination. Anti-Ségrégation. Nous sommes contre quiconque désirant appliquer quelque forme de ségrégation, ou de discrimination contre nous, parce que nous n’avons pas la chance d’être d’une couleur acceptable à vos yeux… (Applaudissements)
Nous ne jugeons pas un homme à cause de la couleur de sa peau. Nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes Blancs ; nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes Noirs ; nous ne vous jugeons pas parce que vous êtes foncés de peau. Nous vous jugeons à cause de ce que vous faites et de ce que vous appliquez. Et aussi longtemps que vous appliquerez le mal, nous serons contre vous. Et pour nous la plus… la pire forme de mal, c’est le mal fondé sur la condamnation d’un homme à cause de la couleur de sa peau. Et je ne pense pas que quelqu’un ici puisse nier que nous vivons dans une société qui ne juge pas un homme uniquement en fonction de ses talents, de son savoir-faire, de sa possibilité… de son milieu, ou de son manque de diplôme. Cette société juge un homme seulement sur la couleur de sa peau. Si vous êtes blancs, vous pouvez avancer, et si vous êtes noir, vous devez vous battre à chaque pas, sans toute fois pouvoir avancer. (Applaudissements)
Nous vivons dans une société entièrement contrôlée par des gens qui croient en la ségrégation. Nous vivons dans une société entièrement contrôlée par des gens qui croient au racisme, et qui pratiquent la ségrégation, la discrimination et le racisme. Nous croyons en une… et je dis qu’elle est contrôlée non pas par des blancs bien intentionnés, mais contrôlée par les ségrégationnistes, les racistes. Et vous pouvez voir par le schéma que cette société suit partout dans le monde. A l’heure actuelle en Asie, l’armée américaine lance ses bombes sur des gens à peau sombre. Vous ne pouvez pas dire que… c’est comme si vous pouviez justifier le fait d’être si loin de chez soi et de lancer des bombes sur quelqu’un d’autre. Si vous habitiez tout près, j’en suis certain, mais vous ne pouvez pas partir si loin de ce pays, lancer des bombes sur quelqu’un d’autre, et justifier votre présence là-bas, pas avec moi. (Applaudissements)
C’est du racisme. Le racisme tel que l’Amérique le pratique. Du racisme qui entraîne une guerre contre le peuple à peau foncée d’Asie, un e autre forme de racisme réside dans le fait d’engager une guerre contre le peuple à peau foncée du Congo… tout comme il entraîne une guerre contre le peuple à peau foncée du Mississipi, de l’Alabama, de Georgie et de Rochester, État de New York. (Applaudissements)
Nous ne sommes pas contre les gens parce qu’ils sont blancs. Mais nous sommes contre ceux qui pratiquent le racisme. Nous sommes contre ceux qui lancent des bombe sur des gens parce que leur couleur a la malchance d’être d’une teinte différente de la vôtre. Et parce que nous sommes contre ça, la presse dit que nous sommes violents. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous sommes pour la paix. Mais les gens contre lesquels nous nous battons sont pour la violence. Vous ne pouvez pas être pacifiques quand vous avez à faire à eux. (Applaudissements)
Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables. C’est toujours ce que fait un criminel. Es vous lancent des bombes, puis vous accusent de vous les lancer vous-mêmes. Ils vous fracassent le crâne, puis vous accusent de vous frapper. C’est ce que les racistes ont toujours fait… le criminel, celui qui développe en une science son processus criminel. Ils appliquent l’action criminelle.
Puis, ils utilisent la presse pour faire de vous une victime… voyez comme la victime est le criminel et le criminel la victime. C’est ainsi qu’ils procèdent. (Applaudissements) (…)
Donc, ils n’aiment rien faire sans le soutien du public blanc. Les racistes qui ont habituellement beaucoup d’influence dans la société, ne font pas un geste sans l’opinion publique à leurs côtés. Alors, ils utilisent la presse pour mettre l’opinion publique de leur côté. Lorsqu’ils veulent supprimer ou opprimer la communauté noire, que font-ils ? Ils prennent les statistiques et, par le biais de la presse les communiquent au public. Es font apparaître que la criminalité est plus élevée dans la communauté noire qu’ailleurs.
Quel effet cela produit-il ? (Applaudissements). Ce message… c’est un message très astucieux utilisé par les racistes pour faire croire aux Blancs qu’ils ne sont pas racistes, que le taux de criminalité dans la communauté noire est très élevé. Cela maintient l’image de criminel de la communauté noire. Et dès que cette impression est donnée, alors on rend possible ou on trace la voie de l’instauration d’un État policier dans la communauté noire, tout en obtenant l’approbation complète du public blanc quand la police y entre et utilise toutes sortes de mesures brutales pour supprimer les Noirs, leur fracasse le crâne, leur lance des chiens, ou des choses de ce genre. Et les Blancs les suivent, parce qu’ils croient que tous là-bas sont des criminels. C’est ce que… la presse fait cela. (Applaudissements)
C’est de l’habileté. Et cette habileté s’appelle… cette science s’appelle : « faire de l’image ». Ils vous tiennent en échec par le biais de cette science de l’imagerie. Ils vous conduisent même au mépris de vous-mêmes en vous donnant une mauvaise image de vous. Certains d’entre nous ont ingurgité cette image, et l’ont digérée… jusqu’à ce que d’eux-mêmes, ils ne veuillent plus vivre dans la communauté noire. Ils ne veuillent plus approcher les Noirs eux-mêmes. (Applaudissements)
C’est une science qu’ils utilisent avec beaucoup d’habileté pour faire du criminel la victime et de la victime, le criminel. Par exemple : pendant les émeutes de Harlem j’étais en Afrique, heureusement ! (rires). Pendant ces émeutes, ou à cause de ces émeutes ou bien après ces émeutes, la presse, à nouveau, a dépeint les émeutiers avec une grande habileté, comme étant des truands, des criminels, des voleurs, parce qu’ils s’étaient approprié des biens.
Maintenant, figurez-vous, il est vrai que des biens ont été détruits. Mais considérons cela sous un autre angle. Dans ces communautés noires, l’économie de la communauté n’est pas entre les mains de l’homme Noir. L’homme Noir n’est pas son propre propriétaire. Les bâtiments dans lesquels il vit appartiennent à d’autres. Les magasins de la communauté sont tenus par d’autres. Tout, dans la communauté est hors de son contrôle. Il n’a rien à dire en la matière, il ne peut rien faire si ce n’est y vivre et payer le loyer le plus élevé en échange de l’habitation la plus médiocre, (applaudissements) payer les prix les plus élevés pour se nourrir, pour la plus mauvaise nourriture. Il est victime de cela, victime de l’exploitation économique, de l’exploitation politique et de tout autre type.
Aujourd’hui, il est si frustré, tellement sous la pression de cette énergie explosive qui l’habite, qu’il voudrait attraper celui qui l’exploite. Mais celui qui l’exploite n’habite pas dans son voisinage. Il est seulement le propriétaire de sa maison. Il est seulement le propriétaire de son magasin. Il est seulement le propriétaire du voisinage. Si bien que lorsque l’homme Noir explose, celui qu’il voudrait attraper n’est pas là. Alors, il détruit ses biens. Ce n’est pas un voleur. Il n’essaie pas de voler vos meubles ou votre nourriture de médiocre qualité. Il veut vous attraper, mais vous n’êtes pas là. (Applaudissements)
Au lieu que les sociologues n’analysent le vrai problème, tel qu’il est, n’essaient de le comprendre, tel qu’il est, ils utilisent la presse pour faire croire que ces gens sont des voleurs, des truands. Non ! ce sont des victimes du vol organisé, des propriétaires organisés qui ne sont rien d’autre, que des voleurs, des marchands qui ne sont rien d’autre que des voleurs, des politiciens qui siègent au gouvernement et qui ne sont rien d’autre que des voleurs complices des propriétaires et des marchands. (Applaudissements)
Mais, une fois de plus, la presse est habituée à faire de la victime le criminel et du criminel la victime… c’est de l’imagerie. Et tout comme cette imagerie est employée à l’échelon local, vous pourrez la comprendre mieux grâce à cet exemple pris au plan international : le meilleur exemple, et le plus récent témoignant de mes paroles se trouve dans la situation du Congo. Écoutez ce qui s’est passé : nous nous sommes trouvés dans une situation où des avions lançaient des bombes sur des villages africains. Un village africain n’a aucune défense contre les bombes ; un village africain ne constitue pas une menace suffisante pour être bombardé ! Les avions lançaient pourtant des bombes sur les villages africains. Et lorsque les bombes frappent, elles ne font pas la distinction entre les amis et les ennemis, elles ne font pas la différence entre les hommes et les femmes. Lorsque les bombes sont lancées sur les villages africains du Congo, elles sont lancées sur des femmes noires, sur des enfants noirs, sur des bébés noirs. Les êtres humains se retrouvent déchiquetés… Je n’ai entendu aucun cri de protestation, aucune compassion à l’égard de ces milliers de Noirs abattus par les avions. (Applaudissements)
Et pourquoi n’y eut-il pas de cris de protestation ? Pourquoi ne nous sommes nous pas sentis concernés ? Parce que une fois de plus, très habilement, la presse fait des victimes les criminels et des criminels, les victimes. (Applaudissements)
(…) Mais c’est une chose que vous devez considérer et à laquelle vous devez répondre. Parce qu’il y a des avions américains, des bombes américaines, des parachutistes américains armés de mitrailleuses. Mais vous savez, ils disent que ce ne sont pas des soldats, qu’ils sont simplement là-bas en services d’escorte, qu’ils ont commencé comme conseillers au Sud Vietnam. Vingt mille hommes uniquement conseillers et uniquement en « service d’escorte ». Ils sont capables de commettre ces tueries, et de s’en tirer à bon compte en les qualifiant d’ « humanitaires », d’actions humanitaires. Ou d’agir au nom de l’ « indépendance », de la « liberté ». Toutes sortes de slogans retentissants, mais c’est un crime de sang-froid, une tuerie. Et c’est fait si habilement, que vous et moi nous qualifions d’êtres subtils, en ce vingtième siècle, sommes capables d’en être les spectateurs et de l’approuver. Simplement parce que tout cela est perpétré contre des hommes à peau noire, par des hommes à peau blanche.
(…) Bien que je vous cite cet exemple, vous pourriez me dire : « Qu’est-ce que cela a-t-il à voir avec l’homme noir, en Amérique ? et qu’est-ce que cela a-t-il à voir avec les relations entre Noirs et Blancs, ici à Rochester ? »
Vous devez comprendre une chose. Jusqu’à 1959, l’image du continent africain fut créée par des ennemis de l’Afrique. L’Afrique était dominée par des puissances extérieures dominée par les européens. Et comme ces européens dominaient le continent africain, ils créèrent eux-mêmes l’image de l’Afrique qui fut projetée à l’étranger. Et ils projetèrent une image négative de l’Afrique et du peuple africain. Une image détestable. Ils nous ont fait croire que l’Afrique était un pays de jungles, d’animaux, un pays de cannibales et de sauvages. C’était une image détestable.
Et parce qu’ils réussissaient si bien à projeter cette image négative de l’Afrique, nous qui, ici à l’ouest, étions d’ancêtres africains, les Afro-américains, nous avons considéré l’Afrique, comme un lieu détestable. Nous avons considéré l’africain comme une personne détestable. Et, se référer à nous comme à des africains, c’était nous prendre pour des serviteurs, des enfants, ou parler de nous d’une façon dont nous ne voulions pas que vous parliez de nous.
Pourquoi ? Parce que ceux qui oppriment savent que l’on ne peut faire haïr les racines, sans faire haïr l’arbre. Vous ne pouvez pas haïr les vôtres, sans finir par vous haïr vous-mêmes. Et puisque nous avons tous des origines africaines, on ne peut nous faire haïr l’Afrique, sans nous faire nous haïr nous-mêmes. Et ils l’ont fait, très habilement.
Quel en a été le résultat ? Ils se sont retrouvés avec vingt-deux millions de Noirs, ici, en Amérique qui haïssaient tout ce qu’il y avait d’africain en eux. Nous haïssions les caractéristiques africaines, les caractéristiques africaines. Nous haïssions nos cheveux, nous haïssions notre nez, la forme de notre nez et celle de nos lèvres, la couleur de notre peau. Oui, nous les haïssions. Et c’est vous qui nous avez appris à nous haïr nous-mêmes simplement en usant de votre stratégie astucieuse pour nous faire haïr la terre de nos ancêtres et le peuple de ce continent…
Aussi longtemps que nous avons haï ce à quoi nous pensions qu’ils ressemblaient, nous avons haï ce à quoi nous ressemblions. Et vous dites que j’enseigne la haine ! Pourquoi ? C’est vous qui nous avez enseigné la haine de nous-mêmes. Vous avez enseigné au monde la haine de tout une race, et vous avez maintenant l’audace de nous blâmer parce que nous vous haïssons, simplement parce que nous refusons la corde que vous nous avez mise au cou. (Applaudissements)
Lorsque vous enseignez à un homme la haine de ses lèvres, des lèvres que Dieu lui a donné, de la forme de ce nez que Dieu lui a donné, de la nature de ces cheveux que Dieu lui a donnés, de la couleur de cette peau que Dieu lui a donnée, vous commettez le crime le plus hideux qu’une race puisse commettre. Et c’est le crime que vous avez commis.
Notre couleur est devenue une chaîne. Une chaîne psychologique. Notre sang… le sang africain… est devenu une chaîne psychologique, une prison parce que nous avions honte. Nous croyons… ils vous le lanceraient à la figure, et vous diraient que non. Mais si, ils en avaient honte ! Nous nous sommes sentis piégés parce que notre peau était noire. Nous nous sommes sentis piégés parce que nous avions du sang africain dans nos veines.
Voici comment vous nous avez emprisonnés. Non pas uniquement en nous émanant ici et en faisant de nous des esclaves. Mais l’image que vous avez créée de notre terre et l’image que vous avez créée de notre peuple sur ce continent était un piège, une prison, une chaîne, c’était la pire forme d’esclavage jamais inventée par une race soi-disant civilisée et une nation civilisée, depuis le commencement du monde.
Vous en voyez encore le résultat dans notre peuple, dans ce pays, aujourd’hui. Parce que nous haïssions notre sang africain, nous ne nous sentions pas à la hauteur, nous nous sentions inférieurs, impuissants et notre sentiment d’impuissance ne nous a pas été favorable. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander de l’aide et vous avez refusé de nous aider. Nous ne nous sentions pas à la hauteur. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander conseil et vous nous avez donné le mauvais conseil. Nous nous sommes tournés vers vous pour vous demander notre chemin et vous nous avez laissé tourner en rond.
Mais un changement est apparu. En nous. Et de quoi provient-il ? En 1985, en Indonésie, à Bandung, un rassemblement d’hommes de peau foncée fut organisé. Ces hommes d’Afrique et d’Asie sont venus ensemble pour la première fois depuis des siècles. Ils n’avaient pas d’armes nucléaire, pas d’aviation, pas de flotte. Ils ont discuté de leur situation et ont découvert une chose que nous tous en commun… l’oppression, l’exploitation, la souffrance. Et nous avions en commun un oppresseur, un exploiteur.
Si un frère venait du Kenya, il appelait son oppresseur, anglais. Si un autre frère venait du Congo, il appelait son oppresseur, belge. Si un autre venait de Guinée, il appelait son oppresseur, français. Mais, quand vous placiez les oppresseurs ensemble, ils avaient tous une chose en commun, ils venaient tous d’Europe. Et cet européen opprimait le peuple d’Afrique et d’Asie.
Et puisque nous pouvions voir que nous partagions l’oppression et l’exploitation en commun, le chagrin, la tristesse et la douleur, en commun, notre peuple a commencé à se rassembler et à décider, à la conférence de Bandung, qu’il était temps d’oublier nos différences. Nous avions des différences. Certains étaient bouddhistes, hindous, chrétiens ou musulmans, certains n’avaient pas de religion. D’autres étaient socialistes, capitalistes, communistes ou ne revendiquaient aucun système économique. Pourtant, malgré toutes ces différences, ils se mirent d’accord sur un point : l’esprit de Bandung était dès lors d’adoucir les ères de différence et d’accentuer les ères communes.
Et ce fut l’esprit de Bandung qui nourrit les flammes du nationalisme et de la liberté non seulement en Asie, mais particulièrement sur le continent africain. De 1955 à 1960, les flammes du nationalisme, de l’indépendance sur le continent africain devinrent si lumineuses et furieuses qu’elles pouvaient tout brûler et tout atteindre sur leur passage. Et ce même esprit ne resta pas en Afrique. Il se faufila subrepticement à l’ouest et pénétra l’âme et le cœur de l’homme Noir, sur le continent américain qui était séparé de l’Afrique depuis quatre cents ans.
Mais ce même désir de liberté qui avait bouleversé l’âme et le cœur de l’homme Noir sur le continent africain, commença à brûler dans l’âme et le cœur de l’homme Noir ici, en Amérique du sud, en Amérique centrale et en Amérique du nord, nous prouvant que nous n’étions pas séparés. Bien qu’il y ait un océan entre nous, nous étions toujours mus par le même battement de cœur.
L’esprit du nationalisme, sur le continent africain… il commença à retomber ; les puissances… les puissances coloniales ne pouvaient rester là. Les Britanniques eurent des problèmes au Kenya, au Nigeria, au Tanganyika, à Zanzibar et dans d’autres pays du Continent. Les Français eurent des problèmes dans toute l’Afrique du Nord équatoriale, y compris en Algérie, qui devient un point de tension extrême pour la France. Le Congo ne voulait plus tolérer la présence belge. Le continent africain tout entier devint explosif entre 1954 et 1955 et jusqu’en 1959. En 1959, ces puissances ne pouvaient plus rester.
Ce n’est pas qu’elles voulaient partir. Ce n’est pas que tout à coup elles devenaient généreuses. Ce n’est pas que tout à coup elles ne souhaitaient plus exploiter les ressources de l’homme noir. Mais, c’est cet esprit d’indépendance qui consumait l’âme et le cœur de l’homme noir.
Il ne s’autorisait plus à être colonisé, opprimé et exploité. Il ressentait cette volonté d’être maître de son existence et de prendre la vie de ceux qui essayaient de lui prendre la sienne. C’était cela, le nouvel esprit.
Ces puissances ne partirent pas, mais que firent-elles ? Lorsque quelqu’un joue au basket-ball, si… vous le regardez… les joueurs de l’équipe adverse le piègent et s’il ne veut pas se débarrasser de la balle, de la laisser entre les mains de l’autre équipe, il doit la passer à quelqu’un qui n’est pas dans une position dangereuse, qui est de la même équipe que lui. Et puisque la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les autres puissances coloniales étaient piégées… se trouvaient exposées en tant que puissances coloniales… elles devaient trouver quelqu’un qui n’étaient pas dans cette position dangereuse, et les seuls à ne pas être dans cette position à l’égard des Africains étaient les États-Unis. Donc, elles passèrent la balle aux États-Unis. Le gouvernement la ramassa et court comme un fou depuis. (Rires et applaudissements)
Dès qu’ils saisirent la balle, ils comprirent qu’ils étaient confrontés à un nouveau problème. Les Africains s’étaient réveillés, et n’avaient plus peur. Il était devenu impossible aux puissances européennes de rester sur le continent de force. Donc, notre ministère des Affaires Étrangères, tout en saisissant la balle, comprit dans sa nouvelle analyse, qu’il faudrait déployer une nouvelle stratégie, s’il fallait remplacer les puissances coloniales européennes.
Quelle fut sa stratégie ? L’approche amicale. Au lieu d’aller sur place, les dents serrées, il a commencé par sourire aux Africains : « Nous sommes vos amis » (…) C’était une approche pleine de bienveillance, philanthropique. Appelez cela du colonialisme bienveillant, de l’impérialisme philanthropique. De l’humanitarisme soutenu par le dollarisme. De la politique de pure forme (tokenism). C’est l’approche qu’il choisit. Il ne s’est pas rendu là-bas avec de bonnes intentions : comment peut-on partir d’ici et se rendre sur le continent africain avec le « peace Corps », les « Cross roads » et d’autres organisations, lorsque l’on pend des Noirs dans le Mississipi ? Comment peut-on faire cela ? (Applaudissements)
(…) On peut considérer la période allant de 1954 à 1964 comme celle de l’émergence de l’État africain. Comme l’État africain a commencé à se dessiner entre 1954 et 1964, quel impact, quel effet cela eut-il sur les Afro-américains ? sur les Noirs américains ? Comme l’homme Noir en Afrique devenait indépendant, cela le mettait dans la position d’être enfin l’artisan de sa propre image. Jusqu’en 1964, lorsque vous et moi pensions à un Africain, nous l’imaginions nu avec des tam-tams et un os dans le nez. Oh oui !
C’était la seule image d’un Africain qui nous venait à l’esprit. Et depuis 1959, lorsqu’ils ont commencé à rejoindre les Nations-Unies et que vous les voyiez à la télévision, vous étiez sous le choc. On vous présentait un Africain parlant un anglais meilleur que le vôtre. Doué d’un raisonnement plus pertinent que le vôtre. Plus libre que vous. Pourquoi ces pays où vous ne pouviez vous rendre ? (Applaudissements. Ces pays où vous ne pouviez pas vous rendre, tout ce qu’il avait à faire était d’enfiler son costume et de marcher juste devant vous. (Rires et applaudissements)
Il devait vous ébranler et ce n’est qu’à ce moment-là, que vous avez commencé à vous réveiller. (Rires)
Donc, les nations africaines ayant gagné leur indépendance, et l’image du continent africain commençant à charger, les choses s’harmonisèrent, l’image de l’Afrique passant du négatif au positif. Inconsciemment. En Occident l’homme Noir commençait à s’identifier à l’image positive qui apparaissait.
Et lorsqu’il vit que l’homme noir du continent africain prenait une assise, il se sentit empli du désir de prendre une assise aussi.
La même image, la même… aussi négative… on entendait parler d’air servile, d’esprit de compromis, de regard empli de crainte… de la même façon. Mais, lorsque nous avons commencé à en savoir plus sur Jomo Kenyatta, Mau-Mau et les autres, on a trouvé des Noirs dans ce pays qui commençaient à suivre la même ligne. Et qui s’en retrouvaient plus proches que certains ne voulaient l’admettre.
Lorsqu’ils virent… tandis qu’ils devaient changer leur approche du peuple du continent africain, ils ont aussi commencé à modifier leur approche des Noirs sur notre continent. Comme ils appliquaient une politique de pure forme (tokenism) et toute une série d’approches amicales, bienveillantes, et philanthropiques du continent africain, qui n’étaient que des efforts de pure forme, ils commencèrent à faire la même chose avec nous, ici, aux États-Unis.
La politique de pure forme (tokenism)… Ils proposèrent toutes sortes de mesures qui n’étaient pas réellement conçus pour résoudre les problèmes. Chacun de leur mouvement n’était qu’un mouvement de pure forme. Ils n’ont jamais entrepris aucune action réaliste, pour réellement résoudre le problème. Ils proposèrent une décision visant à désagréger la Cour Suprême, qu’ils n’ont jamais appliquée. Pas même à Rochester et encore moins dans le Mississipi. (Applaudissements)
Ils ont grugé les gens du Mississipi en essayant de leur faire croire qu’ils allaient imposer la déségrégation à l’université du Mississipi. Ils y firent venir un Nègre, escorté d’environ six mille à quinze mille soldats, si je me souviens bien. Et je crois bien que ça leur a coûté six millions de dollars. (Rires)
(…) Cette politique de pure forme, consistait en un programme conçu pour protéger les avantages d’à peine quelques Noirs, soigneusement sélectionnés. On leur attribuait une importante situation, ce qui leur permettait ensuite de proclamer haut et fort : « Regardez comme nous faisons des progrès ! » Ils devraient plutôt dire, regarde comme il fait des progrès. Car, pendant que ces Nègres choisis avec soin, vivaient comme des princes, parmi les Blancs, siégeaient à Washington D.C., les masses d’hommes et de femmes noirs de ce pays continuaient à vivre dans des bidonvilles et dans le ghetto. Les masses, (applaudissements) les masses d’hommes et de femmes noirs dans ce pays demeuraient sans emploi et les masses d’hommes et de femmes Noirs de ce pays continuaient à fréquenter les pires écoles et à recevoir le plus mauvais enseignement.
C’est à cette même époque qu’apparut le mouvement des Black Muslims. Et voici ce qu’il fit : jusqu’à l’apparition du mouvement des Black Muslims , le NAACP était considéré comme un mouvement radical. (Rires). Ils voulurent faire une enquête à son sujet. CORE et tous les autres étaient suspects… étaient l’objet de suspicions. On n’entendait plus parler de King. Lorsque les Black, Muslims sont arrivés avec leur discours, l’homme blanc s’est écrié : « Heureusement que le NAACP existe ! » (Rires et applaudissements).
Le mouvement des Black, Muslims avait rendu le NAACP acceptable aux yeux des blancs. Il avait rendu ses leaders acceptables. Alors, ils commencèrent à se référer à eux comme à des leaders Noirs responsables. (Rires) Ce qui signifiaient qu’ils étaient responsables aux yeux des Blancs (applaudissements). Je ne suis pas en train d’attaquer le NAACP. Je vous en parle (rires). Et ce qui le rend si ridicule, vous ne pouvez pas le nier. (Rires).
(…) Le mouvement en soi, attire les éléments de la communauté noire, les plus militants, les plus insatisfaits, les plus intransigeants. Il attira aussi les éléments le plus jeunes de la communauté noire. Le mouvement se développant, il attira les éléments militants, intransigeants et insatisfaits.
Le mouvement était censé être fondé sur la religion de l’islam et par conséquent être un mouvement religieux. Cependant, parce que le monde de l’islam et le monde des musulmans orthodoxes, n’auraient jamais reconnu l’appartenance véritable des Black Muslims à l’islam, il prit ceux d’entre nous qui étaient dans une sorte de vide religieux. Il nous mit dans la position de nous identifier nous-mêmes par le biais de la religion, tandis que le monde dans lequel cette religion était pratiquée, nous rejetait parce ,que nous n’étions pas des pratiquants véritables, des pratiquants de cette religion.
Le gouvernement essaya de nous étiqueter comme politiques, plus que comme religieux de telle sorte qu’il pouvait nous accuser de sédition et de subversion. C’était la seule raison. Mais, bien qu’il nous ait étiqueté comme politiques, parce qu’aucun engagement politique ne nous a autorisé, nous étions dans le vide politiquement. Nous étions dans un vide religieux. Nous étions dans un vide politique. Nous étions aliénés, en fait, coupés de tout type d’activités, même avec le monde contre lequel nous nous battions.
(…) Nous pouvions alors comprendre qu’il nous fallait agir, et ceux qui, parmi nous, étaient activistes commencèrent à se sentir insatisfaits, désillusionnés. La dissension s’installa en définitive, et nous nous séparâmes. Ceux qui rompirent étaient les vrais activistes du mouvement. Ils étaient suffisamment intelligents pour vouloir un programme qui nous permettrait de nous battre pour les droits de tous les Noirs, ici, à l’Ouest.
Cependant, nous voulions aussi notre religion. Si bien que lorsque nous avons quitté le mouvement, la première chose que nous fîmes, fut de nous regrouper au sein d’une nouvelle organisation : « la Mosquée musulmane », dont le siège se trouve à New York. Dans cette organisation, nous avons adopté la religion musulmane, réelle et orthodoxe, qui est une religion de l’islam, une religion de fraternité. Tandis que nous acceptions cette religion et mettions en place cette organisation qui nous permettait de pratiquer cette religion… immédiatement, cette « Mosquée musulmane » particulière était reconnue et acceptée par les officiels religieux du monde musulman.
Nous avons compris en même temps que nous avions un problème dans cette société qui dépassait la religion. Et c’est pour cette raison que nous avons fondé l’Organisation de l’Unité Afroaméricaine, à laquelle tous pouvaient se joindre dans la communauté, grâce à un programme d’action visant à la reconnaissance et au respect des Noirs, en tant qu’être humains.
La parole d’ordre de l’Organisation de l’Unité Afroaméricaine est « Par tous les moyens nécessaires ». Nous ne croyons pas en une lutte menant à… dont les règles sont fixées par ceux qui nous suppriment. Nous ne croyons pas en une lutte dont les règles sont fixées par ceux qui nous exploitent. Nous ne croyons pas pouvoir continuer la bataille en essayant de gagner l’affection de ceux qui nous oppriment et nous exploitent depuis si longtemps.
Nous croyons en la légitimité de notre combat. Nous croyons en la légitimité de nos revendications. Nous croyons que les pratiques mauvaises à l’encontre des Noirs dans cette société sont criminelles et que ceux qui engagent de telles pratiques criminelles ne sont rien d’autre que des criminels. Et nous estimons être en droit de nous battre contre ce criminels, par tous les moyens nécessaires.
Ceci ne veut pas dire que nous sommes pour la violence. Mais nous… nous avons vu l’incapacité du gouvernement fédéral, son manque d’absolu de disposition à protéger les vies et les biens des Noirs. Nous avons vu où les Blancs racistes et organisés, les membres du Klu-Klux-Klan, ceux du Citizen’s Council et les autres peuvent aller dans la communauté noire, pour prendre un homme noir et le faire disparaître, sans que rien ne soit fait. Nous avons vu qu’ils peuvent y entrer. (Applaudissements).
Nous avons à nouveau analysé notre condition. Si nous remontons à 1939, les Noirs, en Amérique, étaient cireurs de chaussures. Les plus éduqués ciraient les chaussures dans le Michigan, à Lansing, la capitale, d’où je viens. Les meilleurs emplois que l’on pouvait trouver, étaient de porter les plateaux et les plats destinés à nourrir les blancs du Country club. Le serveur était toujours considéré comme ayant la plus enviable position, parce qu’il occupait un bon emploi, au milieu des « bons » blancs, vous voyez ! (Rires).
(…) Ça, c’était la condition du Noir jusqu’en 1939… jusqu’à ce que la guerre commence, nous étions confinés dans ce rôle domestique. Lorsque la guerre a éclaté, ils ne voulaient même pas que nous nous enrôlions dans l’armée. Un Noir n’avait pas le droit de s’engager sous les drapeaux. Le pouvait-il ou pas ? Non ! vous ne pouviez pas vous engager dans la marine. Vous vous souvenez ? Ils n’en prenaient pas un seul. C’était en 1939, aux États-Unis d’Amérique !
Ils nous ont appris à chanter : « Sweet land of liberty » et tout le reste. Mais non ! vous ne pouviez pas vous engager. Vous ne pouviez pas incorporer la marine non plus, ils ne voulaient pas que vous vous engagiez. Ils ne prenaient que des blancs. ils n’avaient pas le droit de nous incorporer, jusqu’à ce que les leaders noirs clament haut et fort. (Rires). Qu’ils disent : « Si les blancs doivent mourir, alors nous devons mourir aussi ». (Rires et applaudissements).
Les leaders noirs envoyèrent un bon nombre de noirs se faire tuer, pendant la Seconde Guerre mondiale. Si bien que lorsque l’Amérique entra dans la guerre, elle manqua très vite d’hommes. Jusqu’à la guerre, vous ne pouviez pas entrer dans une usine. J’habitais à Lansing où se trouvaient les usines Oldsmobile et Reo. Il y en avait environ trois dans toute l’usine, et chacun tenait son balai. Ils avaient fait des études. Us étaient allés à l’école. Je crois même que l’un d’entre eux était allé au collège. Il était diplômé de « balaillogie ». (Rires).
Lorsque la vie est devenue difficile, et que l’on a manqué d’hommes, alors, ils nous ont laissé entrer à l’usine. Sans que nous ayons fait le moindre effort. Sans aucun réveil moral soudain. Ils avaient besoin de nous. Ils avaient besoin de main-d’œuvre, de toutes sortes d’ouvriers. Et lorsque la situation devint désespérée et que le besoin se fit sentir, ils ouvrirent tout grand les portes de l’usine et nous firent entrer.
Alors, nous avons appris à faire fonctionner les machines, lorsqu’ils avaient besoin de nous. Ils firent entrer nos femmes ainsi que nos hommes. Comme nous commencions à faire marcher les machines, nous avons commencé à gagner plus d’argent. Comme nous gagnions plus d’argent, nous pouvions vivre dans un meilleur quartier. Comme nous avions changé de quartier, nous allions dans une école un peu meilleure. Comme nous étions dans une école un peu meilleure, nous voulions recevoir un enseignement un peu meilleur, et nous nous trouvions dans de meilleures dispositions pour trouver un emploi un peu meilleur.
Ceci ne provenait pas d’un changement d’inclination de leur part. Ceci ne correspondait à un réveil soudain de leur conscience morale. C’était Hitler. C’était Tojo. C’était Staline. Oui, c’était la pression de l’extérieur, mondiale, qui nous donnait cette possibilité de faire quelques pas en avant.
Pourquoi ne nous autorisèrent-ils pas à nous engager dans l’armée, dès le début ? Ils nous avaient si mal traités, ils avaient peur qu’en nous plaçant dans l’armée, en nous donnant un fusil et en nous montrant comment l’utiliser (rires)… ils avaient peur de ne pas avoir à nous dire sur quoi tirer ! (Rires et applaudissements).
Ils n’auraient probablement pas eu à le faire. C’était leur conscience. Je fais remarquer cela pour insister sur le fait que ce n’est pas un changement d’inclination de la part d’Oncle Sam qui permit à certains d’entre nous de faire quelques pas en avant. C’était la pression mondiale. C’était la menace qui provenait de l’extérieure, le danger venant de l’extérieur qui provoqua… qui occupa son esprit et qui l’obligea à nous autoriser, à vous et à moi, de nous lever un peu plus. Ce n’est pas parce qu’il voulait que nous levions. Ce n’est pas parce que qu’il voulait que nous avancions. Mais parce qu’il était forcé de le faire.
Une fois que vous analysez correctement ces éléments qui ont ouvert les portes, même si elles le furent de force, quand vous considérez leur nature, vous comprendrez mieux votre situation, aujourd’hui. Et vous comprendrez mieux la stratégie que vous devez suivre aujourd’hui. tout mouvement vers la liberté du peuple Noir, s’il est limité à la seule Amérique, est voué à l’échec. (Applaudissements).
Aussi longtemps que votre problème ne sera de portée américaine, vos seuls alliés seront les Américains. Aussi longtemps qu’il paraîtra sous la dénomination de droits civiques, il demeurera un problème intérieur dépendant de la juridiction du gouvernement des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis est constitué de ségrégationnistes et de racistes. Les hommes les plus puissants du gouvernement sont-ils racistes. (…).
Maintenant, qu’allons-nous faire ? Comment allons-nous trouver justice avec un Congrès qu’ils contrôlent, un sénat qu’ils contrôlent, une Maison Blanche qu’ils contrôlent une Cour Suprême qu’ils contrôlent ?
Regardez cette décision déplorable rendue par la Cour Suprême. Mes frères, regardez donc ! Ne savez-vous pas que ces messieurs de la Cour Suprême sont passés maîtres dans l’art du juridique… pas uniquement du droit, mais de la phraséologie juridique. Ils sont devenus si bons maîtres en l’art du langage juridique, qu’ils ont pu sans difficulté rendre un décret sur la déségrégation scolaire, et en termes si bien choisis que personne n’aurait pu le contourner. Ils ont proposé cette chose tournée de si belle manière, que dix années plus tard, on y trouve toutes sortes de vides. Ils savaient très bien ce qu’ils faisaient. Il feignent de vous donner quelque chose, tout en sachant à chaque fois que vous ne pourrez jamais l’utiliser.
L’année dernière, ils ont déposé un projet de loi sur les Droits Civiques à grand renfort de publicité, un peu partout dans le monde, comme si cela devait nous conduire à la Terre Promise de l’intégration. Oh oui ! La semaine dernière, le Bon Révérend Martin Luther King est sorti de prison et s’est rendu à Washington D.C., disant qu’il demanderait chaque jour une nouvelle loi sur la protection du droit de vote des Noirs en Alabama. Pourquoi ? Vous venez à peine d’obtenir une loi. Vous venez à peine d’obtenir le projet de loi sur les Droits Civiques. Vous voulez dire que cette loi dont les mérites furent si longtemps vantés, ne donne même pas suffisamment de pouvoir au gouvernement fédéral pour protéger les Noirs d’Alabama qui n’ont qu’un seul désir, celui de s’inscrire sur les listes électorales ? Pourquoi cette autre ruse infecte, parce qu’ils… nous ont eu par la ruse, année après année. une autre ruse infecte. (Applaudissements).
Donc, depuis nous voyons… je ne veux pas que vous pensiez que je professe la haine. J’aime tous ceux qui m’aiment. (Rires). Mais je peux vous assurer que je n’aime pas ceux qui ne m’aiment pas. (Rires).
Donc, depuis que nous avons compris ce subterfuge, cette supercherie, cette manipulation… non seulement au niveau fédéral, mais national, local, à tous les niveaux. La jeune génération de Noirs qui arrive peut voir qu’aussi longtemps que nous attendrons le Congrès, le Sénat, la Cour Suprême ou le Président pour résoudre nos problèmes, nous serons relégués à être serviteurs pendant encore mille ans. Or, ces temps sont révolus.
Depuis la proposition du projet de loi sur les Droits Civiques… j’ai vu des diplomates africains aux Nations-Unies exprimer haut et fort leur indignation contre l’injustice perpétrée contre les Noirs au Mozambique, en Angola, au Congo et en Afrique du Sud et je me suis demandé comment et pourquoi ils pouvaient rentrer à leur hôtel, allumer la télévision et voir des chiens mordre des Noirs, juste au coin de la rue, des policiers saccager des magasins de Noirs à coups de matraques, juste au coin de la rue, et diriger vers les Noirs leurs lances à eau de pression si forte que leurs vêtements s’en trouvaient mis en pièces, juste au bas de la rue. Je me demandais comment ils pouvaient dire tout ce qu’ils disaient sur ce qui se passait en Angola, au Mozambique et ailleurs, voir ce qui se passait juste au coin de la rue, et montrer à la tribune des Nations-Unies sans rien permettrait un règlement de la situation, avant qu’elle ne devienne en dire explosive et incontrôlable. Je vous remercie. (Applaudissement).
Je suis donc allé en discuter avec certains d’entre eux. Ils m’ont alors dit qu’aussi longtemps que le Noir d’Amérique appellerait sa lutte, une lutte pour les Droits Civiques… que dans le contexte des Droits Civiques, cela resterait intérieur et demeurerait partie intégrante de la juridiction des États-Unis. Et que, si quiconque se permettait d’émettre le moindre commentaire à ce sujet, il serait considéré comme une violation des lois et des règles du protocole. La différence avec les autres est qu’ils ne considèrent pas leurs revendication comme des revendications concernant les Droits Civiques, mais les Droits de l’Homme. Les Droits Civiques appartiennent à la juridiction de leur pays, tandis que les Droits de l’Homme font partie de la Charte des Nations Unies.
Toutes les nations qui ont signé la Charte des Nation-Unies, ont voté la Déclaration des Droits de l’Homme et quiconque considère ses revendications comme étant une violation des Droits de l’Homme, peut les porter devant les Nations-Unies et les faire ainsi porter à la connaissance du Monde. Car, aussi longtemps que vous les considérez comme Droits Civiques, vos seuls alliés seront les membres de la communauté avoisinante, dont la plupart sont responsables de l’injustice causée. Mais dès lors que vous les considérerez comme Droits de l’Homme, leur portée deviendra internationale et vous pourrez les porter devant la Cour Mondiale. Vous pourrez les porter à la connaissance du Monde. Et chacun, partout sur cette terre, pourra devenir votre allié.
L’une des premières dispositions que nous ayons prise, pour ceux d’entre nous qui ont rejoint l’Organisation de l’Unité Afro-américaine, était de présenter un programme qui donnerait à nos revendications une portée internationale et qui montrerait au monde que notre problème n’est plus un problème Noir, ou un problème américain, mais un problème humain. Un problème qui concerne l’humanité. Et un problème qui devrait concerner tous les aspects de l’humanité. Un problème si complexe pour l’Oncle Sam, qu’il lui fut impossible de le résoudre. En conséquence, nous aimerions créer un corps et entrer en consultation avec ceux dont la position nous aiderait à trouver une forme d’ajustement qui permettrait un règlement de la situation, avant qu’elle ne devienne explosive et incontrôlable. Je vous remercie. » (Applaudissement).
(Traduit par Pascal About)
Naya - 16 février 2015
SOURCE : Multitudes
Pour y voir plus clair dans les salles obscures